

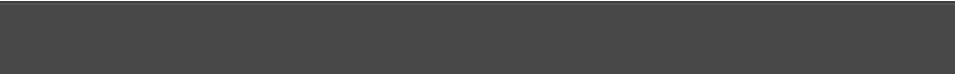
© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr
La flotte de Napoléon III - Documents

Les canons de marine russes et français à Sébastopol (1)
Claude Millé
Etat de l'artillerie des marines européennes en 1854
Au début de la guerre de Crimée les canons de toutes les marines sont à âme lisse, les recherches sur la future artillerie rayée et le
chargement par la culasse ont commencé, mais on en est encore aux tâtonnements et aux projets non aboutis: le piémontais Cavalli propose
en 1845 un canon rayé à fermeture de culasse à coin qui tire des obus munis de deux ailettes, il poursuit ses études en Suède chez le baron
suédois Wahrendorff. Celui-ci expérimente en Prusse son système identique, et pour cause, à celui de Cavalli. Le système Wahrendorff ne sera
pas convaincant. Cela se traduira à la fin,, après 1855, par le système Krupp.. Ce dernier réussira seul par la suite à maitriser les problèmes
d'étancheité aux gaz inhérents à ce système (obturateurs), là où avaient échoué Cavalli, Wahrendorff et Armstrong.
Le belge Montigny construit un canon à chargement par la culasse dont quelques
exemplaires seront achetés par le gouvernement russe En Autriche, on essaie de
remplacer la poudre noire par le fulmi-coton. Les russes, avec leurs édinorogs,
traduction russe du mot licorne, utilisent les canon-obusiers depuis 1757. En
Angleterre, indépendamment des travaux de Withworth et Armstrong, le système
Lancaster a déjà vu le jour, puisqu'au siège de Sébastopol on verra huit canons
Lancaster: à l'essai, dont trois explosèrent. L'âme du canon est légèrement
elliptique, l'éllipse affecte un mouvement hélicoïdal sur la longueur de la pièce.
L'obus est ogival et a une ceinture de plomb qui est censée épouser le profil de
l'ellipse, donc donner au projectile un mouvement rotatif à la sortie de la bouche.
C'est un canon rayé se chargeant par la bouche. Mais «... cette artillerie fit plus de
mal anx anglais qu'aux russes » (Aloncle; Etudes sur l'artillerie navale). Quand
l'obus se coinçait, le canon
explosait..Il faut croire qu'à ses débuts en Crimée le système Lancaster paraissait cependant
prometteur puisqu'il semble que des débuts de commande de la France eurent lieu en
1855. Tout fut annulé définitivement en 1858 avec l'avènement du canon de marine français
Mle 58-60 rayé, fretté à chargement par la bouche.
Enfin, il faut noter en France les
travaux du capitaine Tamisier, son
canon rayé et ses obus ogivaux à
ailettes. Delvigne, officier français,
inventeur d'un fusil rayé en 1826,
se penche vers 1844 sur un modèle
de canon rayé, au polygone de
Gâvres. Egalement à Gâvres, depuis 1840, Treuille de Beaulieu travaille sur un canon
rayé se chargeant par la culasse. Il sortira entre 1855 et 1858 le canon de marine
rayé, mais encore se chargeant par la bouche,. La fermeture de culasse à filets
interrompus de Treuille de Beaulieu va apparaître en 1860, seulement dans la
marine..
En résumé, en Europe comme aux Etats-Unis, les projets furent innombrables mais
beaucoup, à la veille de la guerre de Crimée, n'étaient pas allés au delà du stade de la
conception et du dessin, bien peu aboutirent à des essais, la plupart de ceux-là
furent rejetés ou ajournés par les Commissions des pays concernés; Seuls en Europe,
les anglais, novateurs, essayèrent le malheureux canon Lancaster, en artillerie rayée.
Armstrong sortira dès la fin de 1855 un canon mieux étudié, en ruban de fer forgé et
âme en acier, rayé, fretté et se chargeant par la culasse grace à une variante du
système à coin de Cavalli, Warendorff et Krupp. Le coin (appelé vent pièce) muni d'
un obturateur en étain et portant la lumière était introduit dans la culasse
verticalement et maintenu par le serrage d'une vis-culasse creuse. Le canon
Armstrong donna satisfaction dans les petits calibres et en version « canon de
campagne » en Nouvelle Zélande et
en Chine.
Les problèmes surgiront quand le
gouvernement anglais demanda une
version bien plus lourde pour la Navy
(110 pounder RBL Rifle Breech
Loader): Les servants peinaient à
soulever les 136 livres du vent pièce,
ils n'avaient comme leurs officiers,
aucune formation spécifique pour le
maniement des nouveaux canons
aux manoeuvres de chargement très
délicates, les obturateurs étaient fragiles. En 1863 et 1864 au Japon, lors des
bombardements de Kagoshima et Shimonoseki, on eut sur HMS Euryale des graves
problèmes de culasse., qui continuèrent ensuite sur HMS Zébra et HMS Marlborough.
Devant l'hostilité des officiers de la Royal Navy et les critiques du concurrent Withworth
(qui ne faisait pas mieux avec sa culasse à vis et charnière) Armstrong reviendra au
chargement par la bouche (RML Rifle Muzzle Loader) jusqu'en 1880.
En 1854 les canons de
marine sont à âme lisse et se chargent par la bouche. Mais des
améliorations dans la mise à feu, le système de visée, l'utilisation des
projectiles explosifs, des étoupilles à friction, rendent les bouches à feu
assez différentes de celles du siècle passé.
Mise à feu – Le boute-feu et sa mèche, comme la platine à silex sont
relégués au second plan. On utilise depuis 1835 un marteau-percuteur qui
frappe sur une étoupille de fulminate de mercure enfoncée dans la lumière.
Constituée de plume remplie de pulvérin et de poudre à mousquet, elle
comporte à son extrémité supérieure et externe une coupelle en papier
contenant du fulminate, qui s'enflamme sous le choc du marteau-percuteur
et communique le feu à la gargousse de poudre propulsive. L'étoupille de
fulminate a vu le jour dès le Premier Empire,en1807.
Pulvérin, poudre à mousquet - Le pulvérin est de la poudre très fine. La
poudre à mousquet a deux proportions particulières. C'est, soit une
omposition de 18 de salpêtre, 7 de soufre et 3 de charbon, ou bien de 18 de
salpêtre, 2 de soufre et 3 de charbon.
La coupelle de l'étoupille se place dans le logement en creux de l'entrée de
la lumière, où frappe le marteau percuteur. Elle est collée sur le corps de
l'étoupille en plume par une colle spéciale, au caséum, également utilisée
pour fixer la coiffe de la fusée de l'obus, comme pour réunir les deux
parties composant l'enveloppe de la gargousse en tissus de serge . La colle au caséum est fabriquée en mélangeant de la chaux vive avec du
fromage blanc non salé.
Une autre étoupille, appelée étoupille à friction est d'origine plus récente. Elle renferme, à l'image de la surface rugueuse indispensable à
l'inflammation de nos allumettes, un rugueux en cuivre, qui, tiré énergiquement au moyen du cordon tire-feu du chef de pièce, enflamme le
mélange de fulminate et de pulvérin qui mettra à travers la lumière le feu à la gargousse. Ce système, assez nouveau en 1854, va suppléer
aussi bien chez les alliés que chez les russes aux absences de marteau-percuteurs des pièces de marine mises à terre.
Meilleurs systèmes de visée – la généralisation des hausses, des guidons de mire à la bouche de la pièce et des fronteaux de mire à mi-
longueur du canon facilite la visée. S'y ajoutent les tables de tir, les tableaux de distance angulaires et les réglages qui prennent en compte la
hauteur des mâts. Désormais les pièces d'artillerie sortant de fonderie portent des trous taraudés qui recevront les organes annexes (supports
de percuteur, de fronteau de mire, de hausse réglable).
Protections des systèmes de visée et de percussion. Une sorte de pièce de bois courte recouvre le dessus de la bouche à feu, protègeant le
marteau percuteur et la mire, logés dans des évidements, c'est la défense. Il en existe aussi pour les caronades.
Types de canons et calibres - En 1854 dans la marine française on distingue les canons ordinaires et caronades (qui tirent des boulets ronds et
pleins) et les canons obusiers dits à la Paixhans (qui tirent des boulets explosifs ronds, que l'on nomme obus). Ils sont tous en fonte de fer
(fonte grise). Ces deux types de bouches à feu tirent leurs
projectiles à tir tendu à l'inverse des mortiers qui sont à tir
courbe. Ceux-ci sont en nombre relativement restreint
dans la marine, . Ils ne sont généralement qu' à bord des
petits navires à voiles appelés galiotes à bombes sous
l'Ancien Régime et bombardes sous le Second Empire (1),
utilisées lors des sièges ou bombardements côtiers. Les
mortiers lancent à tir courbe, donc sans précision, des
boulets explosifs nommés bombes (2). En 1854 il ne reste
que quelques bombardes,à voiles qui seront utilisées dans
la Baltique en 1855 lors du bombardement de Sveaborg,
remorquées par des canonnières à hélice, et peu en
Crimée, les combats ayant lieu à terre. Cependant, on
installera en Crimée deux mortiers à plaque (3) sur certains
avisos à roues. Il y eut ainsi à Sébastopol, à la fin du conflit,
4 bombardes françaises de ce type (Cassini, Sésostris,
Tenare et Vautour), avec 6 anglaises.
notes :
1) On comptait 5 bombardes à voiles sur les listes de la
Flotte en 1855 (Bombe, Fournaise, Tocsin, Torche et Trombe) construites en 1854-55 à Lorient sur plans anglais. Ces bâtiments ne furent pas
trouvés valables par les français, qui les transformèrent en 1857-59 en citernes flottantes portuaires. (Cdt Alain Demerliac)
2) Il faut noter que la plupart des mortiers utilisés par les belligérants lors du siège de Sébastopol étaient des mortiers des armées de terre.
Dans les récits de l'époque, on appelait alors bombes tous les projectiles explosifs, qi'ils soient tirés par les mortiers ou les canons obusiers. Le
vrai nom du projectile du canon-obusier est obus..
3) Mortiers à plaques: En bronze ou en fonte de fer, ils sont coulés avec leur plate-forme ou plaque, qui leur sert d'affût.
_________
En 1854 les canons et les caronades sont encore désignés par
le poids en livres du projectile , la livre française correspondant
à 0,489 gr.et la livre anglaise à 0,453gr Ce n'est qu'en 1856 que
le calibre en France sera désigné par le poids du projectile en
Kgs. On a uniformisé les calibres, le plus utilisé est le canon de
30 (ou de 16 cm). Il se décline en quatre modèles, le N° 1, N° 2,
N° 3 et N° 4, suivant la longueur du tube.
Les canons-obusiers sont désignés par le diamètre en cm de
leur âme, et curieusement pour certains modèles par le poids
en livres d'un projectile plein correspondant au diamètre de
leur, âme.
C'est ainsi que pour l'obusier de 22 cm on trouve trois appellations: on l'appelle « de 80 » pour le modèle 1827 uniquement, « 22 cm N° 1 »
pour les modèles 1827, 1841, 1842 et 1849, longs et « 22 cm N°2 » pour les modèles 1842 et 1849. courts
Nota: comme notre article se développera autour des canons de marine utilisés lors du siège, donc à terre, nous ne nous intéresserons qu'aux
types de canons débarqués et à leur calibre. Ce sont pour la plupart des canons obusiers de 22 et 16 cm, et des canons de 50 livres (19,4 cm),
de 30 (16,4 cm) et 24 (15,2 cm). Tous les calibres plus petits, à la puissance de tir inopérante ne furent pas concernés. Les caronades furent
bien souvent exclues aussi, à cause de leur portée trop faible.
Affûts - Ils sont en bois d'orme, soit à 4 roues soit à échantignolles. Dans ce cas les deux roues arrières sont remplacées par un sabot de bois à
l'arrière de chaque flasque, qui par son frottement sur le bordage du pont limite le recul. Les canons-obusiers, au recul violent, ont des affûts
à échantignolles. Leur désavantage est la difficulté de déplacement latéral pour la visée, augmentée par le poids accentué de l'ensemble, près
de 3,7 tonnes. On déplace l'arrière du canon-obusier en le soulevant à l'aide d'un levier directeur, grand bras de levier de fer porté par deux
petites roulettes. Cet accessoire nouveau fait partie des nombreux objets auxiliaires de l'artillerie navale que l'on nomme assortiments.
En 1850 et depuis une dizaine d'années, on monte les canons sur des châssis où glissent les affûts, à roues ou échantignolles, munis d'un axe
de pivotement à l'avant, que l'on nomme cheville ouvrière et dont la partie centrale longitudinale se nomme flèche directrice . Ce dispositif
facilite le pointage horizontal avec le pivotement de l'ensemble autour de la cheville ouvrière. Il permet en outre, en donnant de la pente au
chemin de roulement longitudinal, de limiter le recul. Bientôt, les bragues ne seront plus fixées sur les murailles des navires, mais sur l'avant
du chassis. Quand on ajoute une vis sous la culasse pour régler le pointage vertical, on a la préfiguration des futurs canons de la nouvelle
artillerie rayée, frettée et se chargeant par la culasse.
Ces futurs canons, en acier, aux affûts de fer et aux mécanismes de plus en plus compliqués seront bien plus lourds. et bien plus difficilement
aptes à une mise à terre comme elle s'est déroulée au siège de Sébastopol. Seuls, les antiques affûts de bois à quatre roulettes de l'ancienne
marine permirent, par leur rusticité, tant du coté russe que du côté allié, une intensive utilisation dans les batteries terrestres.
Les anspects, autres leviers qui prennent appui sur les adents de l'affût pour le pointage en hauteur, calé avec les coussins et des coins de
mire.
Les écouvillons et les tire-bourres, nettoient l'âme des particules de poudre ou de restes d'enveloppes de gargousse encore en ignition, les
refouloirs enfonçent gargousses, valets et projectiles Leur hampe porte des repères en encoches destinés à pouvoir dans l'obscurité vérifier si
la charge est bien enfoncée au fond de l'âme., Les cuillères, en bois et cuivre rouge (pour éviter toute étincelle) permettent de retirer une
charge. Les dégorgeoirs sont utilisés par le chef de pièce pour dégager le conduit de la lumière des poussières pouvant l'obstruer, il sert aussi à
percer la gargousse. Certains, plus gros, sont à vrille. L'épinglette, plus petite, sert à faire descendre la poudre d'amorce dans la lumière.
Canon-obusiers - ils seront acceptés au début avec
beaucoup de réticence par les diverses marines à cause des
risques que faisaient courir les projectiles explosifs à des
navires en bois. On les doit à Paixhans, officier de l'armée de
terre, lequel dut nécessairement connaître aux batailles
d'Austerlitz, la Moscowa et Borodino, l'existence des
obusiers russes licornes.
Les canon-obusiers Paixhans tirent des boulets ronds
explosifs appelés obus, ou plus populairement bombes, au
caractère destructeur bien plus important que celui des
boulets pleins.
A Sinope en 1853, l'escadre russe de l'amiral Pavel Nakhimov détruisit en quelques heures la flotte turque d'Osman Pacha grâce à ses canon-
obusiers, dont les turcs étaient dépourvus.
Les obus sont tirés ensabotés, c'est à dire liés à un sabot de bois fixé par des attaches de fer blanc ou de
cuivre sur leur arrière, côté gargousse. Le sabot empêche le projectile de tourner pendant son parcours
dans l'âme, en le guidant. Il protège la fusée, placée en avant, qui le fera exploser après avoir été
enflammée elle-même par la gargousse à la mise à feu. La fusée fera exploser la poudre du boulet creux
après son temps de combustion, qui est généralement compris entre 22 et 24 secondes.
obus de 27 cm ensabotté
L'obus n'explose donc pas à sa percussion sur le but, il est dit fusant. Il faudra attendre la venue des obus
ogivaux pour avoir des projectiles percutants bien que la fusée percutante du lieutenant Billette ait été
connue depuis 1847. Vu le caractère dangereux des obus lors de leur transport ou leur manutention, parce
qu'ils sont stockés à bord avec leur sabot, leur charge et leur fusée, ils sont rangés dans des caisses
individuelles en bois. La fusée est en bois d'orme,conique pour pouvoir être enfoncée de force dans son
logement du boulet sphérique creux. Une série de trous à déboucher au moment du tir permet le réglage
du retard à l'explosion.du projectile.
Pour évoquer les artilleries des marines russes et françaises lors de la guerre de Crimée de 1854-55, il est
auparavant nécessaire d'évaluer la flotte russe par rapport à la puissante flotte alliée Celle-ci est composée
de navires de guerre français, anglais et turcs, dont beaucoup, à l'inverse des russes, sont non seulement à
voiles mais aussi à vapeur.
Flotte russe de la mer Noire
Il s'agit de la flotte d'une mer que l'on pouvait souvent considérer
comme fermée à cause des relations continuellement tendues avec
la Turquie, ennemi héréditaire et riveraine des passages du
Bosphore et des Dardanelles vers la Méditerranée; Les navires de
guerre à voiles, vaisseaux, frégates et petites unités sont construits
à Nicolaiev, sur le Dniepr.
La Flotte russe peinte par Aivazovsky
On y lance de magnifiques trois ponts, le Parish, le Grand Duc
Constantin, le Douze Apôtres, le Tri Sviatitelia, le Varshava. . Les
constructeurs navals sont réputés (Vorobiev, Tcherniavsky,
Apostoli, Anisimov, Dimitriev, ils ont les grades militaires de
capitaines ou colonels), la main d'oeuvre est qualifiée, mais la
construction souffre d'un handicap, l'absence de bois de chêne due
à un manque d'approvisionnement local aggravé par les difficultés
de communication dans l'immense Russie. Alors, on utilise un peu trop le pin et le sapin. Cela donne des constructions qui vieillissent vite.
Fait aggravant: les eaux du port de Sébastopol sont infectées d'un ver de la famille des tarets qui abîme très vite les carènes non revêtues de
cuivre, c'est à dire les petites unités. D'où l'existence de « la baie du Carènage » dans le port de Sébastopol. Les vaisseaux et frégates sont
cependant bien doublés de cuivre: Les vainqueurs trouvèrent à la fin du siège, dans les réserves de l'arsenal: 52.000 kgs de vieux cuivre
provenant des doublages.
Les canons sont fondus à Kherson, au dessus de Nikolaiev.
L'artisan principal du renouveau de la flotte est l'amiral Lazarev (1788-1851). Lazarev reçut son éducation martime en Angleterre (il était en
1805 à Trafalgar,) il fit trois fois le tour du monde, navigua en Alaska, dans l'Antarctique et le Pacifique et dirigea, la flotte russe de la Baltique
puis, en1833 celle de la mer Noire où il termina sa carrière comme gouverneur de Sébastopol.et de Nikolaiev.
Les russes lui doivent le renforcement des fortifications de Sébastopol (hélas seulement du côté mer), l'essor d la ville, la construction d'un
grand port de guerre avec ses magasins, hôpitaux, bassins de radoub. Il fut l'artisan de la qualité des équipages de la marine russe et de la
grande valeur des amiraux Kornilov, Istomine et Nakhimov qui laissèrent leur vie lors du siège de 1854-55.
Fait notable, l'influence anglaise se retrouve dans beaucoup de domaines : construction navale (mise en application du système à membrures
croisées de l'anglais Sepping), armements, travaux portuaires. C'est une compagnie anglaise qui construisit les bassins de radoub. .
La faiblesse de la flotte russe de la mer Noire résidait surtout sur l'absence complète de vaisseaux et frégates à hélice. Les vapeurs à roues,
tous achetés en Angleterre et armés seulement de un ou deux canons ne pouvaient être inclus dans une escadre de combat (Wladimir,
Gromonostz, Bessarabie, Crimée, Odessa, Elborouz, Chersonèse, Mogoursky, Maladetz, Boetz, Grznii, Savernia-Suezda (Etoile du Nord),
Argonaute, Colchide, Donaï (Danube), Turok (Turc, ex- transport turc capturé Medjari-Tedjaret). Tous ces vapeurs furent largement utilisés
dans la grande rade de Sébastopol comme appuis-feu ponctuels et transports de troupes d'urgence. Ils transporèrent l'arrière-garde vers la
rive nord, une fois les troupes russes évacuées par le pont de radeaux.. Les russes coulèrent ensuite leurs vapeurs
. Seul le vapeur Wladimir, appelé frégate parce que plus important que les autres sortit deux fois de la grande rade pour affronter dans de
petites escarmouches des vapeurs anglais et français, avec le vapeur Chersonèse.
Pendant la guerre de Crimée on commençait à, construire à Nikolaiev deux vaisseaux mixtes à hélice, semblables au Napoléon français.
Le principal responsable de l'absence de vaisseaux et frégates mixtes était l'amiral prince Alexandre Sergueievich Menchikov (1787-1869). A
partir de 1830, Menchikov affirmait que « la vapeur et l'hélice sont sans intêret dans les applications militaires »
« . Chef des forces terrestres et navales en Crimée en 1854, ses erreurs de jugement sont à compter parmi ls causes des désastres russes de
l'Alma, Balaklava et Inkerman.. C'est sur ses instances que fut coulée la majeure partie de la flotte à l'entrée de la rade, alors que l'amiral
Kornilov proposait une sortie désespérée (14 vaisseaux, 7 frégates, une corvette et deux bricks, tous à voiles, contre 33 vaisseaux, 40 frégates
et corvettes à vapeur, 13 frégates à voiles) » (Alexandre PROTTO - Au service du pavillon de St André dans la marine impériale russe - ouvrage
publié à compte d'auteur).


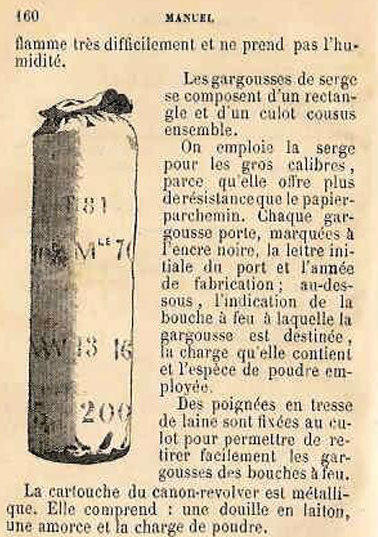
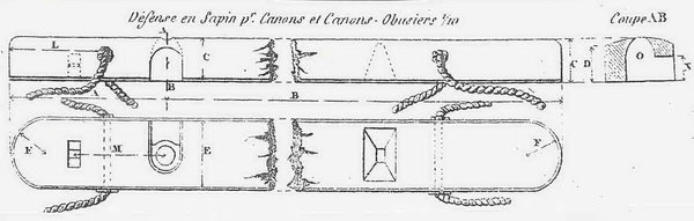
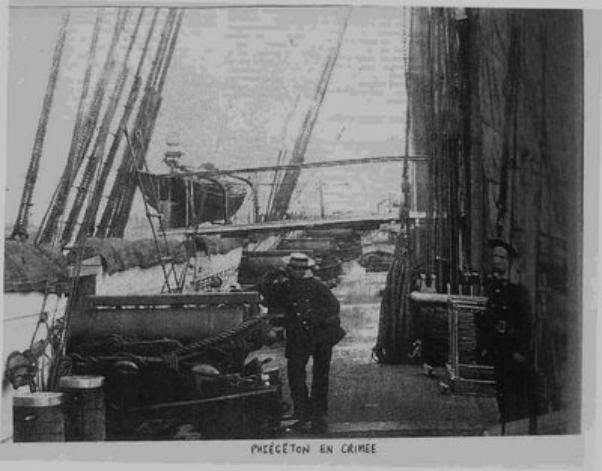
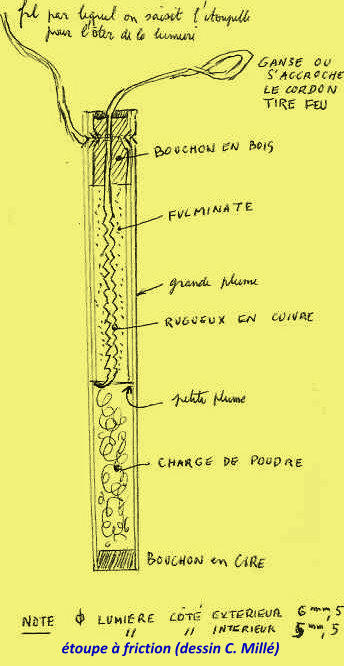

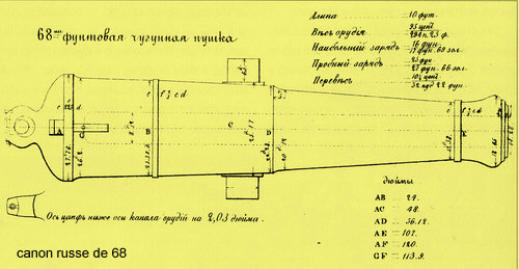
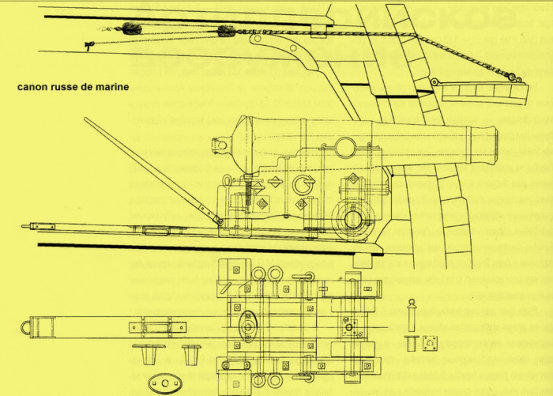
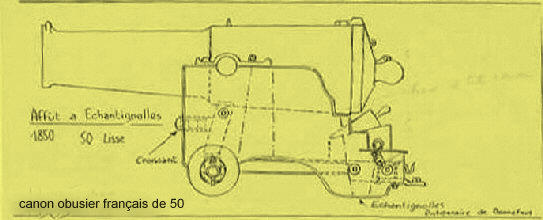
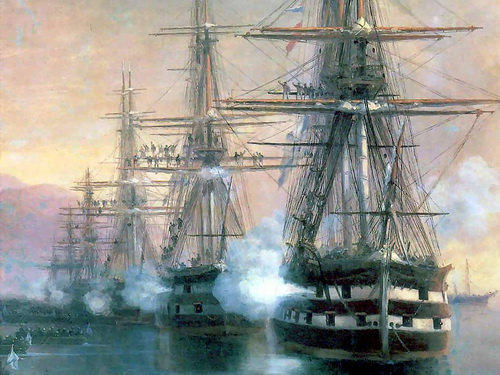
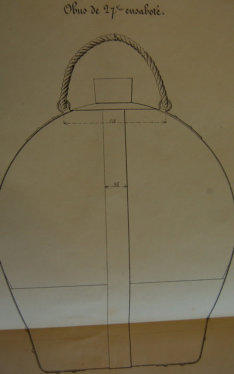





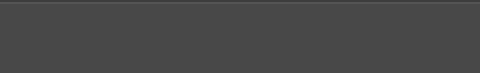
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu
eiusmod lorem
MonsiteWeb.com



- Accueil
- Index-a
- D-a
- D-a
- V-a
- V-nb
- V-nc
- V-nd
- V-na-a2-a
- V-na-a3-a
- V-na-a4-a
- V-na-a5-a
- V-na-a6-a
- V-na-a7-a
- V-na-a8-a
- V-na-a9-a
- V-na-a9-a
- Fl1860-a
- V_gouv-a
- V_puits-a
- V_puits1-a
- V_puits2-a
- V_gouv-a
- Tem-a
- Tem_les1-a
- Tem_les1-a
- Tem_les-a
- Tem_thib-a
- Tem_gir1-a
- Tem_gir2-a
- Tem_gir3-a
- Tem_themis-b
- Tem_toulon1-a
- Tem_toulon2-a
- Tem_lesg-a
- Tem_isis-a
- Tem_dordo-a
- Tem_primauguet-a
- Tem_dordo-a
- Arm-a
- Arm-seb1-a
- Arm-seb2-a
- Arm-seb3-a
- Arm-can-a
- Arm-can-a
- T-a
- T-b
- Z-a
- T-hel-a
- T-hel-a
- H-a
- H_1870-a
- H_1870-b
- H_1870-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_mexique-a
- H_crime-a
- H-mex-a
- H-mex2-a
- H-mex2-a
- Ch-a
- Ch-liste-a
- Per-a
- Per-a
- Per-a

























