

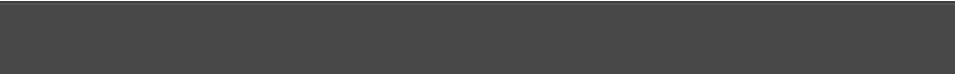
© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr
La flotte de Napoléon III - Documents

Machines des navires à roues par Jean Marpeaux
Ces machines étaient caractérisées par une vitesse de rotation peu élevée (15 à 30 t/mn), et leur mécanisme devait être conçu pour
s’accommoder du faible espace disponible entre le sommet du cylindre et l’arbre moteur qu’il était chargé d’entraîner. Différentes dispositions
furent successivement proposées pour résoudre ce problème d’encombrement.
Machines à balanciers latéraux
Les machines à balanciers latéraux furent au début les plus utilisées. La tige du
piston portait à sa partie supérieure une courte barre horizontale aux
extrémités de laquelle s’articulaient deux bielles actionnant des balanciers
situés de part et d’autre du cylindre, et de l’autre extrémité de chacun de ces
balanciers partait une bielle qui actionnait le vilebrequin de l’arbre moteur. Les
machines de ce type étaient robustes mais lourdes, et elles nécessitaient pour
les supporter des bâtis particulièrement massifs.
machine à balanciers latéraux
Machines à bielles directes
Afin d’obtenir des mécanismes plus légers, Seaward mit au point en 1837 les
machines à bielles directes dans lesquelles la liaison entre le vilebrequin de
l’arbre et la tige du piston était assurée par une bielle articulée à l’extrémité de
cette dernière.
machine à bielle directe
Lorsque les cylindres étaient verticaux le manque d'espace amenait toutefois à utiliser des bielles
courtes qui au cours de leur fonctionnement s’écartaient notablement de la verticale, ce qui était
peu favorable à la transmission des forces. Une meilleure disposition consistait comme dans
l’exemple ci-dessus à incliner les cylindres, ce qui permettait de rendre les bielles plus longues et
ainsi de les faire travailler dans de meilleures conditions.
Machines à double traverse
Les machines à double traverse en T furent conçues par Maudslay en
1839. Elles permettaient de disposer d’une bielle longue, ce qui leur assurait un fonctionnement satisfaisant en dépit du
faible espace disponible. Pour cela chacun des cylindres de la machine était dédoublé en deux cylindres jumeaux dont les
tiges de piston étaient reliées par une double traverse en forme de T. A la base du T se trouvait un axe horizontal autour
duquel venait s'articuler la bielle qui actionnait le vilebrequin. En dépit du doublement du nombre de cylindres cette
machine était elle aussi plus légère qu’une machine à balanciers latéraux.
machine à double traverse en T
Machines à cylindres oscillants
Dans les machines à cylindres oscillants (apparues un peu après 1840) chacun des cylindres
était mobile autour d’un axe creux à l’intérieur duquel passaient les circuits d’admission et
d’échappement de la vapeur, et la tige du piston était connectée directement au
vilebrequin de l’arbre moteur. Ce type de machine dont le nombre de pièces était réduit
jouissait d’un devis de poids particulièrement favorable, aussi fut-il souvent utilisé, mais
toute la difficulté consistait à obtenir une bonne étanchéité des joints tournants qui
assuraient le passage de la vapeur.
machine à cylindres oscillants
Les roues
Le principal défaut des roues était que leur rendement, c'est-à-dire leur aptitude à utiliser Machine à cylindres oscillants efficacement l’énergie
produite par la machine, dépendait de leur immersion, ce rendement étant optimum lorsque l’eau affleurait le bord supérieur de la pale située à
la verticale de l’axe. Si les pales n’étaient pas enfoncées assez profondément elles étaient peu efficaces. Si par contre leur immersion était trop
forte elles attaquaient la surface de l’eau sous un angle important, et la résistance exercée par le liquide sur celles qui s’enfonçaient à l’avant et sur
celles qui émergeaient à l’arrière dissipait une part non négligeable de la puissance de la machine. La charge que les navires à roues pouvaient
transporter était donc limitée, aussi dans les marines de commerce ne furent-ils employés que comme remorqueurs ou pour le transport de la
poste et des passagers.
Et comme cette limitation de poids s'appliquait
également à la quantité de charbon susceptible
d'être embarquée, les premiers vapeurs dont les
machines avaient un faible rendement ne pouvaient
franchir que de courtes distances entre deux
ravitaillements, aussi furent-ils tous équipés d'un
gréement. Associé à la machine, celui-ci permettait
de réduire la consommation par vent favorable, mais
il pouvait aussi suppléer à celle-ci si le combustible
était épuisé ou en cas de panne mécanique. A une
époque où les dépôts de charbon étaient encore
rares le gréement permettait également à ces
bâtiments d'effectuer de longues traversées pour se
rendre sur leur lieu d'utilisation sans faire appel à
leur machine.
roue à pattes articulées
Toutefois lorsque celle-ci était arrêtée les pales
entravaient la marche du navire. Pour l'éviter la
solution la plus radicale consistait à démonter les
pales inférieures, voire les roues elles mêmes, mais le
démontage, puis la remise en place des pales étaient des manoeuvres longues et délicates qui ne pouvait s'effectuer que dans des zones abritées.
Une autre manière de réduire la traînée des roues consista à doter certaines unités de dispositifs permettant de les désaccoupler des machines
pour les laisser tourner librement, tandis qu’à bord d’autres bâtiments (dont certaines frégates transatlantiques de 1840) les machines étaient
pourvues de vannes permettant aux cylindres d’être mis en communication directe avec l’atmosphère afin de réduire le freinage exercé par le
mécanisme.
On mit également au point des roues dont les pales pouvaient être déplacées le long des rayons, ce qui permettait de les sortir de l'eau pour
éviter qu'elles entravent la marche à la voile, mais aussi de s'affranchir des pertes de rendement lorsque le navire était en surcharge. Toutefois
chacune des solutions proposées présentait des inconvénients, et le problème de la navigation à la voile des navires à roues ne fut jamais résolu
de manière pleinement satisfaisante
Divers procédés permirent également d'accroître le rendement des roues. L'un d'entre eux consista à fractionner chaque pale en plusieurs
éléments décalés disposés le long d'une courbe appelée cycloïde. Ces différents éléments heurtaient alors la surface de l’eau successivement et
chacun sous un angle d’incidence plus favorable. Enfin la solution la plus satisfaisante fut la roue à pales articulées : chacune des pales était alors
mobile autour d’un axe, et grâce à la bielle qui la reliait à une couronne fixe excentrée par rapport à l’arbre moteur elle pouvait être maintenue
dans une position proche de la verticale pendant le temps durant lequel elle était immergée, mais la complexité de ce dispositif accroissait le
risque d'avaries par gros temps.
Jean Marpeaux
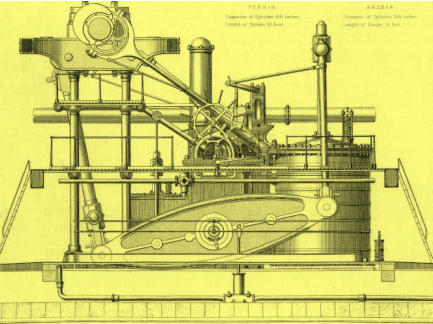

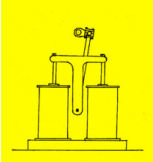
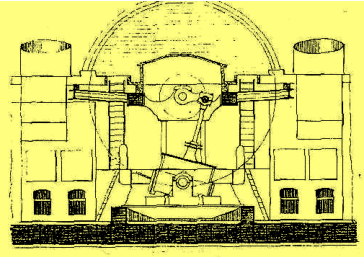
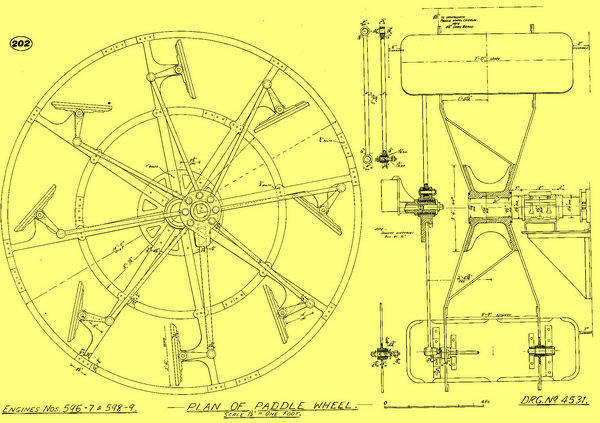



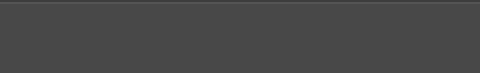
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu
eiusmod lorem
MonsiteWeb.com



- Accueil
- Index-a
- D-a
- D-a
- V-a
- V-nb
- V-nc
- V-nd
- V-na-a2-a
- V-na-a3-a
- V-na-a4-a
- V-na-a5-a
- V-na-a6-a
- V-na-a7-a
- V-na-a8-a
- V-na-a9-a
- V-na-a9-a
- Fl1860-a
- V_gouv-a
- V_puits-a
- V_puits1-a
- V_puits2-a
- V_gouv-a
- Tem-a
- Tem_les1-a
- Tem_les1-a
- Tem_les-a
- Tem_thib-a
- Tem_gir1-a
- Tem_gir2-a
- Tem_gir3-a
- Tem_themis-b
- Tem_toulon1-a
- Tem_toulon2-a
- Tem_lesg-a
- Tem_isis-a
- Tem_dordo-a
- Tem_primauguet-a
- Tem_dordo-a
- Arm-a
- Arm-seb1-a
- Arm-seb2-a
- Arm-seb3-a
- Arm-can-a
- Arm-can-a
- T-a
- T-b
- Z-a
- T-hel-a
- T-hel-a
- H-a
- H_1870-a
- H_1870-b
- H_1870-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_mexique-a
- H_crime-a
- H-mex-a
- H-mex2-a
- H-mex2-a
- Ch-a
- Ch-liste-a
- Per-a
- Per-a
- Per-a

























