

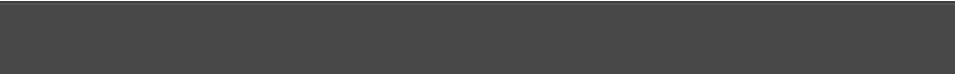
© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr
La flotte de Napoléon III - Documents

Témoignages
Charles-Henri Bonnescuelle de Lespinois (1)

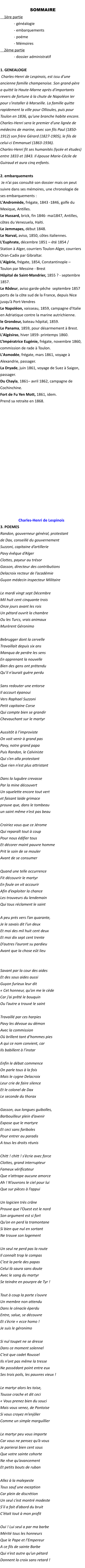

4. MEMOIRES
1843
Lorsque je concourus pour le grade de chirurgien de 3ème classe de la marine, nous étions
quarante deux concurrents pour sept places.
Au jugement de tous mes camarades et des concurrents eux mêmes, nous nous disputions la
première place avec un nommé Romain, dit l’Anglais (sa mère était Anglaise).
Mais à cette époque, et jusqu’à l’abolition des concours, messieurs les chefs, très accessibles
à toutes les influences, se jouaient de l’avenir des jeunes gens, si bien que si M. Guès, alors
capitaine de frégate, n’avait pas fait une scène à tout casser à M. Aubert, médecin en chef, beau
père de monsieur Dupuy de Lorme, j’aurais été mis de coté. On me reçut le septième et pour se
venger d’avoir été forcé d’être juste, le dit sieur Aubert, président du conseil de santé, me
réserva pour l’embarquement de la frégate l’Andromède qui allait faire trois ans de station dans
le golfe du Mexique et Antilles.
On allait passer l’hivernage au mouillage des trois Ilets. On y mourait d’ennui quand on n’y
mourait pas d’autre chose.
Vers la fin de 1846, je fus envoyé sur le brick le Hussard, ou il y avait une épidémie de
dysenterie ; le second chirurgien était mort antérieurement, et le major était malade à l’hôpital
de saint Pierre Martinique.
C’est sur ce bateau que j’ai voyagé et vu beaucoup de pays très intéressants, car nous avons
visité tous les ports de la cote ferme du Venezuela, de la Nouvelle Grenade, tout le périple de
Saint Domingue, et surtout la partie espagnole, sa capitale Santo Dominguo, ou on conserve
dans la cathédrale, la croix plantée par Christophe Colomb en prenant possession du pays.
J’ai entendu là une messe de minuit de Noël des plus originales ; environ une trentaine de
flûtes et autant de guitares accompagnaient les cantiques liturgiques sur temps de valse.
C’était joli au possible, et nous aurions voulu que cela ne finisse jamais.
C’est cette nuit là que l’on passe à danser la tertullia dans toutes les maisons et à se rafraîchir,
que le consul Américain nous présente à un officier d’artillerie Suisse, qui faisait son tour du
monde et que nous sûmes plus tard être le futur empereur des Français Napoléon III.
Cela nous expliqua pourquoi il déclina toujours l’offre que nous lui fîmes de venir déjeuner à
bord ; il avait peur d’être arrêté et remis en cage.
Rentré à Brest en mai 1847
Nous terminâmes cette mémorable campagne par un séjour assez prolongé à Saint
Domingue, partie Française. Quel beau pays ! Et quel dommage d’avoir perdu une si belle
colonie !
J’ai beaucoup couru dans l’intérieur : à chasser ramasser des coquilles, et voir les restes des
travaux de colonisation accomplis par nos aïeux, qui avaient fait de ce pays un véritable Eden,
avec ses routes carrossables de tous les cotés, dont on voit le tracé malgré la richesse de la
végétation qui envahit tout. De distance en distance on voyait encore les bornes militaires de la
route marquées de trois fleurs de lys. Partout des champs immenses de cotonniers, de caféiers
venant sans culture, embroussaillés comme les roumias chez nous, ne trouvant même pas de
travailleurs pour cueillir la récolte. Il y avait des bois de bananiers qui couvraient plusieurs
hectares d’une seule tenue. Des richesses incalculables se perdaient par suite de la paresse, de
l’insouciance des nègres.
Il m’a été donné de fréquenter dans la haute société du pays. J’ai fait danser la fille du
président Richer, négresse du plus beau noir, jolie bien faite, parlant parfaitement Français,
élevée à Paris dans un pensionnat ou la plupart des jeunes filles du grand monde d’Haïti étaient
envoyées pour faire leur éducation : très au courant du monde du high-life parisien, j’avoue que
par moments elle m’embarrassait pas mal.
Son père, nègre pur sang, était borgne. Sous le règne du roi Christophe, ce tyran nègre donna
l’ordre de purger le pays de tous les mulâtres : Richer, qui était alors général, pour plaire à son
souverain, massacra de sa propre main sa femme et un de ses enfants qui étaient mulâtres ; et
l’on a raconté que, malgré sa férocité, Christophe fut si indigné de cet acte atroce, qu’il tira son
épée et creva l’œil de Richer, après quoi il lui pardonna en faveur de l’intention.
J’ai assisté aux funérailles splendides de ce gredin, et j’ai vu nommer son successeur,
Soulouque, qui, plus tard, s’est proclamé empereur et a surpassé, en cruautés et en horreurs de
toute espèces, tous ceux qui étaient avant lui, les maîtres de ce malheureux pays. J’ai connu à
Port au Prince, un mulâtre, M. de Vineux, qui était docteur en médecine de la faculté de Paris ; il
était très bien. Le pays était alors gouverné par M. Dupuis, mulâtre, docteur en droit de la
faculté de Paris, qui avait organisé toutes les branches de l’administration ; il avait crée un sénat,
une chambre des députés, un clergé séculier, enfin tous les rouages d’un état social dont il faisait
jouer toutes les ficelles sous le couvert du nègre président, nullité dorée et particulièrement
ignorante de tout ce qui se faisait.
Mon cordonnier à Port au Prince, du reste très bon ouvrier, était le sénateur Marius, Brutus
Coriolan, rien que çà ! ; il me donnait des cartes d’entrée au sénat. Il fallait voir ces faces noires
sous une toge rouge, une espèce de péplum bleu ciel, et un chapeau absolument semblable à
ceux des prud’hommes pécheurs de la Ciotat, seulement les plumes étaient bleues et rouges,
etc.…. Ce que l’on s’engueulait dans ce sénat…les sacrés pendus, sacrés coch… etc. etc.
pleuvaient comme grêle. Comme tous les peuples souverains, ils n’aimaient pas la contradiction
: Soulouque les mis tous d’accord en les faisant massacrer en masse, parce que disait-il
« Negue qui tiru z’argent passé milati »
« Les nègres qui sont riches sont également mulâtres. »
Eh! Mon Dieu ! Actuellement un ouvrier bon travailleur, économe, qui a mis de coté de quoi
subvenir à ses besoins dans sa vieillesse ne passe t-il pas aux yeux des socialistes pour un infâme
capitaliste ? A la couleur près, on y est.
1847
Je ralliais Toulon, mon port d’attache, après un séjour de trois mois à Brest, ou j’avais désarmé
le brick le Hussard. Je consacrais quelques jours à Paris ou je venais pour la première fois.
Le bal Mabille aux Champs-Elysées était alors dans tout son éclat, et l’on était sûr en y allant,
d’y voir, outre les célébrités chorégraphiques, la plus part des célébrités contemporaines dans la
politique, les arts, la littérature et les armées. J’y vis, en effet, Thiers et son ami Mignet qui
venaient voir le grand Chicard, le roi du cancan. La séduisante Frisette, et la célèbre Céleste
Mogador, fille d’un pauvre officier qui l’avait fait élever à saint Denis, et qui avait en sortant de
là, outre son chic incroyable et sa parfaite éducation, une puissance de séduction toute
particulière, car elle n’était pas vraiment jolie, au point qu’elle fut épousée légitimement plus
tard, par le comte de Chabrillant, consul général au Chili.
Je visitais les principaux monuments, les musées, tout cela à la hâte, car j’étais pressé de
rentrer à la maison après trois ans d’absence, et surtout en sentant combien mes parents étaient
tristes depuis la mort de mon frère Pétrus en 1845, et faut il le dire aussi il me tardait de revoir
ma fiancée, et de me mettre à penser à un grade supérieur.
J’allais remercier, et prendre les commissions pour les parents du camarade qui m’avait piloté
à Paris ; nous eûmes le temps d’aller voir les quais du Louvre et des Tuileries une revue de
cavalerie passée par le roi Louis Philippe Ier (la dernière qu’il ait passée), nous le vîmes après
cela descendre de cheval dans la cour du Louvre et d’assez près pour avoir gardé la mémoire de
cette tête toute blanche, avec ses favoris blancs et ses saluts gracieux à tout son entourage.
Puis le lendemain je montais en diligence. Dieu nous garde de les voir jamais revenir, j’étais
tellement moulu par cette traversée de Paris à Toulon que j’en eu la grippe. Enfin je guéris et je
repris mon service jusque dans les premiers jours de 1848, ou je fus embarqué sur le vaisseau le
Jemmapes en commission de rade.
Entre temps je préparais mon concours, et faisais mes préparatifs de mariage.
Février 1848
Il faut noter cela…. Nous étions encore au téléphone Chappe avec ses grands bras articulés
qui tranchant, sur les hauteurs dans l’azur du ciel, semblaient faire des gestes désespérés pour
exprimer leur pensée. Les nouvelles par conséquent, ne nous arrivaient pas, comme
aujourd’hui, avec une vitesse de soixante quinze mille lieues à la seconde.
Je venais de faire une garde de rade, et après déjeuner, nous descendons à terre, dans la rue
des chaudronniers (rue d’Alger actuelle), je rencontre une longue colonne de jeunes gens et
d’hommes mûrs, avec tambours et drapeau tricolore en tête, chantant la Marseillaise. J’aperçois
dans le nombre un camarade et je lui demande en patois : uï, Azau ! qué l’a ? Mon cher, me dit
Azau, nous sommes en république, le Roi et en fuite en Angleterre.
Cela me parut drôle tout de même ; car on ne parlait de rien quelques jours auparavant, si ce
n’est qu’on avait l’intention d’organiser à Paris un banquet réformiste, les gens de bon sens
disaient : « ma foi, ils vont bien dîner ou plutôt mal dîner, beaucoup parler, se griser de paroles,
et puis, on s’en ira chacun chez soi. » Il n’en fut rien ; après avoir mis le feu aux poudres, les
organisateurs du banquet, voyant que ceux qu’ils voulaient conduire les conduisaient eux
même, et beaucoup plus loin qu’ils n’auraient voulu, regrettèrent ce qu’ils avaient fait, il n’était
plus temps ; c’est toujours le sort de ceux qui, par des paroles enflammées, surexcitent les foules
dont ils ne peuvent plus se rendre maîtres. Ils obéissent au lieu de se faire obéir, ou même
simplement écouter, et dans cette surprise (car la révolution de 1848 ne fut pas autre chose
qu’une surprise), les mauvais éléments de cette population interlope de Paris qu’on ne voit
monter à la surface, comme une mauvaise écume sociale, que dans les temps troublés, fit courir
à la France un danger terrible, qui ne fut conjuré que par la parole entraînante et patriotique de
Lamartine.
Tous les meneurs ambitieux de bas étage, en grande partie orgueilleux, les fous sincères
même, organisèrent un gouvernement provisoire, et, pour lui donner certaines garanties aux
yeux de la masse de la nation, ils eurent soin d’y appeler un petit nombre de républicains
sincères, probes, modérés qui servirent d’étiquettes. Mais chacun voulu gouverner à sa guise ;
autant de membres du gouvernement, autant de théories gouvernementales, depuis la
république de Lycurgue jusqu’à celle du communiste Cabet.
Déjà parmi les membres les plus exaltés de cette nouvelle république, on peut voir évoluer le
germe de la dictature socialiste. Et l’échantillon le plus remarquable fut la circulaire du citoyen
Ledru Rollin qui ne prêchait autre chose qu’une guerre civile impitoyable. Cela indigna tous les
honnêtes gens, tous les hommes partisans d’une forme de gouvernement aussi bonne qu’une
autre, à condition que tous les intérêts et toutes les libertés nécessaires seront respectées.
J’ai l’honneur de me comporter au nombre de ceux-ci, et je me rappelle que, me trouvant au
café de la Marine, pour voir ce que disaient les journaux, le jour que parût insérée, en grosse
lettres dans un journal radical, la circulaire de Ledru Rollin, je fus pris d’une sainte colère ainsi
que quelques officiers de marine qui se trouvaient là, tandis que deux de mes camarades,
chirurgiens de 3me classe comme moi, avaient l’air d’exulter et de trouver cela admirable.
Je me fis incontinent donner une feuille de papier par le garçon de café, et d’inspiration, tout
d’une traite j’écrivis ces quelques vers que je collais sur une glace du café bien en vue :
Liberté de mourir de faim
Egalité dans la misère
Fraternité de Caïn
Voilà ce que Ledru coquin
Nous promet dans sa circulaire
Applaudissement d’un coté, fureur de l’autre, il manqua y avoir des duels ce jour là. Il y en
eut un surtout, nommé Jean, qui doit être encore vivant à Aups ou il exerçait la médecine, étant
démissionnaire, qui s’approchant de moi, me dit « tu es un réactionnaire, eh bien ! Malheur à
toi, si nous te voyons derrière les barricades, nous ne te ferons pas de quartier » je lui répondis «
si je te prends derrière une barricade je te sauverai pour qu’on ne te fasse pas de mal »
Alors me dit-il, tu es pour la république honnête ! Mais alors lui dis-je comment appelleras-
tu la tienne ? Voilà où on en était, les meilleurs garçons étaient comme affolés.
A l’heure actuelle tous ces enragés de 1848 seraient regardés comme des républicains à
l’eau de rose.
Cependant il faut toujours rendre justice à chacun, même et surtout à ses adversaires, cette
levée de boucliers républicaine, à part quelques exceptions, fût généreuse et mit la probité à
l’ordre du jour, non en parole mais en action. De plus dans son rêve d’égalité sociale le
républicain de 1848 chercha à élever le peuple à sa hauteur, mais n’eut jamais consenti à
descendre au niveau de son inférieur social. C’était un rêve moralisateur, tandis qu’aujourd’hui,
c’est tout le contraire.
26 Avril 1848
Cependant la politique ne m’absorbait nullement et j’avais d’autres sujets d’occupation, qui
me paraissaient beaucoup plus attractifs.
Je préparais mon concours, et j’allais, tous les soirs chauffer les pieds de ma belle. Je
concourus le 15 octobre et jours suivants. Malgré que j’eusse donné des séances meilleures que
celles de mes concurrents, je ne suis point nommé, on me donna pour raison que, comme c’était
mon premier concours pour la 2m classe, je ne pouvais pas être reçu d’emblée ;à cela je
répondis que si je n’avais pas concouru, c’est que j’étais à me battre avec une fièvre jaune et la
dysenterie dans les colonies, tandis que mes concurrents, qui étaient de la même promotion de
3m classe que moi et qui s’étaient gobergés tout le temps sur des vaisseaux en rade, avaient pu
concourir, et que je méritais pas qu’on m’imputât à tort les services plus pénibles et plus
dangereux que les leurs.
La vraie raison était qu’il y avait un fils d’amiral et deux fortement protégés à faire passer, et
qui m’ont avoué plus tard que la manière dont j’avais concouru leur avait donné la colique.
Je me consolais en me jetant dans les bras de ma femme…
Octobre 1849
Mais je pris ma revanche au concours suivant, car je fus reçu le premier avec 21 points de
différence avec le second, ce détail je le sais de la bouche même de Vicary (contre amiral), qui
était alors lieutenant de vaisseau et aide de camp du préfet maritime.
Pendant que les arbitres de nos destinées étaient à délibérer chez le préfet, nous étions
avec Gués à arpenter le terrain devant la porte de la préfecture. A un moment donné, Vicary
sort et Gues, qui le connaissait, lui demanda ou en était la discussion des titres des candidats.
Vicary lui répondit que les 1ères classe étaient nommés ; que pour la 2ème classe, il n’y en avait
qu’un de nommé à l’unanimité, sans discussion, parce qu’il avait vingt et un points de différence
avec le second.
Gues lui demanda alors comment s’appelait celui-là. Vicary lui répondit « c’est un noble, M.
de Lespinois », « que je vous présente » lui répartit Gués ; alors Vicary me serra la main, et me
dit qu’il était vraiment heureux d’avoir fait ma connaissance de cette manière.
Dans ce moment, nous avions loué un petit logement à Ollioules, à cause de la santé de mon
beau père. Je partis en courant, et c’est en courant que j’arrivais à Ollioules ; j’étais si essoufflé
(car, je ne me rappelle pas le temps que j’ai mis à y aller, mais j’étais jeune et leste) que je ne
pouvais plus parler : ils prirent peur, craignant que je n’eusse échoué. Je le leur fis venir piano,
piano. On t’a peut être reçu le dernier ? Non. L’avant dernier ? Non (il y avait 8 places).
Quand décidément, ils apprirent que j’étais reçu le premier ce fut un débordement de joie. Il y
a des moments où il fait bon vivre ; mais que d’angoisses et de tristesses pour ce moment de
plaisir !
Cependant l’esprit de l’homme est ainsi fait qu’il oublie facilement toutes les affres par
lesquelles il a passé, pour se souvenir que du court moment de bonheur qui leur a succédé !
C’est égal, il faut être doué de quelque penchant à la philosophie pour être si joyeux, si
enthousiasmé par l’obtention d’un grade qui nous donnait à cette époque, largement 180 francs
par mois !!! Misère humaine ! Et comme il faut que la jeunesse, l’espérance de l’avenir meilleur
vous fassent voir toutes choses à travers un kaléidoscope incomparable.
1850
En 1850, j’embarquai sur l’aviso le Narval qui faisait des voyages mensuels à Civita-
Vecchia (port de Rome actuel). C’était à l’époque ou nous avions pris Rome sur les républicains
italiens, pour y réintégrer le pape Pie IX.
Nous faisions des voyages de transport, surtout de passagers, politiques, militaires, religieux,
etc.
C’est dans un de ces voyages que nous transportâmes de Civitavecchia à Toulon, le célèbre
Henri Cernuschi, un riche banquier de Milan, lieutenant de Mazzini, et un des triumvirs qui
défendirent Rome contre notre corps expéditionnaire.
C’était à cette époque, un grand jeune homme de 28 ans, blond aux grands yeux bleus, d’une
figure intelligente et excessivement sympathique. Il défendit Rome jusqu’au dernier moment,
n’ayant aucune arme sur lui, entraînant les défenseurs de cette cité par l’exemple et
l’entraînement de la parole, un drapeau à la main.
Lorsqu’il passa devant le conseil de guerre, assemblé pour juger ceux qu’on appelait les
insurgés, le général commandant en chef le complimenta sur son courage, et le conseil l’acquitta
à l’unanimité il se retira à Paris, qu’il adopta comme une seconde patrie.
Il parait qu’il faisait bon usage de sa grande fortune, il faisait beaucoup de bien. Et j’ai lu dans
les journaux, il y a deux ou trois ans (1894), une notice nécrologique sur lui ou l’on énumérait les
actes de bienfaisance et de générosité qu’il a fait pendant de longues années.
Ce descendant des anciens Lombards, dont il présentait tous les caractères ethnographiques,
a même légué une forte somme pour un établissement de bienfaisance ; Il était artiste jusqu’au
bout des ongles ; il a fait un voyage au Japon exprès pour acquérir des bronzes d’art qui lui ont
énormément coûté, et son cabinet de travail était dit-on, un véritable musé artistique d’une
grande valeur.
--------------------------------
J’opère, ici, une petite régression pour constater quel était l’esprit qui régnait à l’école, et
l’idéal caressé par messieurs les professeurs et les chefs de la médecine navale, L’on peut dire en
toute sincérité, que les grades, que l’on obtenait au concours, n’étaient, en réalité, que des prix
de mémoire, ce qui fait, qu’à part quelques hommes de réelle valeur, nous avons vu tant de
médiocrités dorées sur tranche, arriver au sommet de l’échelle hiérarchique.
Naturellement, ces messieurs n’admettaient pas que quiconque put avoir des idées autres
que celles qui étaient professées dans l’école, ce qui fait que l’on éteignait tout esprit d’initiative
chez les jeunes gens etc. on les dégoûtait même de chercher à sortir de l’ornière. Je me rappelle
qu’étant de 3m classe je présentais un jour, au conseil de santé un nouveau procédé pour le
traitement de l’hydrocèle. J’avais lu dans un compte rendu de l’académie de médecine les
expériences faites par Jules Cloquet qui, pour empêcher que les adhérences de la plèvre se
produisent après la ponction de la poitrine, et l’évacuation du liquide, on faisait des injections
dans la cavité pleurale de gaz oxydable d’azote, connu aussi sous le nom de gaz hilarant. Cela
m’avait frappé, d’autant plus que l’injection du gaz ne donnait lieu à aucun espèce d’accident, et
je me dis, avec raison, que si on appliquait ce procédé à l’hydrocèle, on éviterait sûrement les
accidents inflammatoires consécutifs à l’injection iodée qui était alors dans toute sa nouveauté,
ayant été inventée par Mr jean Joseph Raymond, ancien chirurgien en chef du port de Toulon.
Je fis un rapport sur cette proposition de procédé ; j’y joignais les dessins schématiques du
petit outillage nécessaire à l’opération, et fier comme Christophe Colomb en découvrant
l’Amérique, je présentais mon œuvre au conseil de santé.
On jeta sur toute mon œuvre un coup d’œil dédaigneux, excepté cependant le professeur
Lauvergne, qui était très lié avec Jules Cloquet, et pour tout compliment on me conseilla de
préparer mon concours…..aganto aco jaco !!!
On poussait si loin cette opposition à tout esprit d’initiative et de progrès, qu’après la guerre
de Crimée, il se passa ceci à la salle des blessés c’était Mr Raynaud Marc qui était directeur, il fit
appeler en pleine salle un nommé Dussaud qui, était auxiliaire, avait été nommé entretenu par
décision ministérielle, pour sa belle conduite en Crimée.
« Qui vous a permis, monsieur de panser cet amputé ? ce n’est qu’un deuxième classe qui
peut le faire »…tout le monde se regardait, pensant qu’il allait le punir … alors Dussaud de
répondre modestement
« Mon Dieu ! Monsieur le directeur, je croyais qu’un chirurgien pouvait bien, quelque soit son
grade, panser un homme qu’il avait amputé lui-même »…. Ah ! dit sèchement monsieur
Raynaud, et il lui tourne le dos sans ajouter une parole.
Le même monsieur Raynaud me fait appeler un jour dans son cabinet et d’un ton sec et dur
me dit !!! qui vous a permis, monsieur, d’écrire des articles dans une revue périodique sans ma
permission ? Je tombais des nues, au premier moment. Puis je viens à me rappeler qu’il y avait
un abbé Henri de Lespinois qui écrivait des articles dans la revue catholique,
Ce ressouvenir me donne envie de rire telle qu’il s’en aperçu sur mon visage, mais je ne lui
laisse pas le temps de revenir à la rescousse, et je lui demande à mon tour, si ce ne serait pas
dans cette revue catholique qu’il aurait vu mon nom, il répond qu’en effet c’est cela. Alors je lui
expliquerai que c’était cette similitude de nom qui l’avait fait tomber dans cette erreur à mon
sujet et que j’étais incapable d’écrire quoi que ce soit dans une revue catholique dont j’ignorai
même l’existence.
Qu’eusse été, mon Dieu ! si j’avais écrit quelque chose touchant la médecine ou la chirurgie !
Monsieur Jules Roux n’était pas de cette école, et il a rompu pas mal de lances avec le dit
Monsieur Raynaud, qui aurait voulu lui interdire d’envoyer des communications à l’académie de
médecine, dont il était membre correspondant.
Et je me rappelle avec plaisir les éloges qu’il me donna, lorsqu’il revint à Paris, ou il était allé
présenter à l’académie de médecine un compresseur artériel pour le traitement des anévrismes.
Il avait l’esprit chercheur et avait parfaitement trouvé un compresseur avec lequel j’ai fait toutes
les expériences nécessaires et très variées à l’hôpital du bagne, in anima vili, mais comme je lui
faisais remarquer, étant son prévôt de salle, on ne pouvait pas savoir au juste le point de
compression, ou il fallait la limiter pour obtenir, ce qu’il appelait, la formation du caillot actif
formé par la nature pour obturer le canal de l’artère.
C’est alors que je lui proposais d’adapter à l’extrémité de son compresseur un petit niveau à
bulle d’air dont les oscillations donnaient le degré de compression auquel il fallait s’arrêter ; Je
dois dire modestement que ce petit appareil fut trouvé très ingénieux et que l’on parla quelque
temps de cette petite chose.
En Décembre 1851 embarqué sur l’Euphrate, je fis une station de quatre années sur la côte
de l’Algérie, faisant des voyages quinquénaires tantôt à Oran, tantôt à Bône. Nous faisions un
véritable service de transports commerciaux, et surtout de passagers de guerre. C’est pendant
ce temps là que je renouai connaissance avec mon oncle Alphonse de Lespinois, ses deux filles,
Victorine et Alphonsine et mon cher et bon Charles, son fils, qui était alors sous officier au train
des équipages militaires.
Lorsque, muni d’une permission de l’amiral de la Roque de Chanfroy, je vins à Médéa pour les
embrasser et passer quelques jours avec eux, ils me reçurent avec le plus vif plaisir. Mon oncle
avait des larmes aux yeux, et tous s’empressaient autour de moi, me demandant des détails sur
la famille.
Ce furent des dîners donnés en mon honneur, des parties de chasse, des cavalcades dans
lesquelles, soit dit passant, je ne brillais pas trop, surtout à coté de Victorine, qui mettait
toujours son cheval à un galop effréné, et qui me fit ce jour là attraper plus de beefsteaks que je
n’en mangerai de ma vie.
C’est à Médéa que je fus présenté au général Yousouf qui est une de ces figures légendaires,
quoique secondaires, d’une époque ou une foule de faits chevaleresques, guerriers, accomplis
par nos officiers et nos soldats, donnaient à notre armée un relief qui n’a pas été effacé.
Yousouf était un jeune enfant italien capturé par les pirates barbaresques sur les côtes de l’île
d’Elbe. Il fut vendu au bey de Tunis comme esclave et faisait un petit service d’intérieur dans le
palais du Bardo. Il fut instruit et catéchisé dans la religion musulmane ; on lui apprit à lire à
écrire etc. ; à mesure qu’il grandissait, on lui donnait des travaux proportionnés à son âge.
Quand il eu une vingtaine d’années, il était chargé d’entretenir et cultiver un jardin intérieur du
harem du Bey. C’était un très joli garçon à la figure ouverte intelligente et passablement
dégourdi. Une fille du Bey ne fut point insensible à tant d’agréments personnels ; il s’en suivit
une liaison qui dura quelque temps, grâce aux précautions dont s’entouraient les deux amants,
car il y allait de la vie à tous les deux. Cependant malgré toutes ces précautions, épiés,
découverts et dénoncés secrètement par un autre esclave, ils furent violemment séparés, et
Yousouf mis en prison en attendant le jugement du Bey.





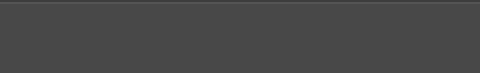
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu
eiusmod lorem
MonsiteWeb.com



- Accueil
- Index-a
- D-a
- D-a
- V-a
- V-nb
- V-nc
- V-nd
- V-na-a2-a
- V-na-a3-a
- V-na-a4-a
- V-na-a5-a
- V-na-a6-a
- V-na-a7-a
- V-na-a8-a
- V-na-a9-a
- V-na-a9-a
- Fl1860-a
- V_gouv-a
- V_puits-a
- V_puits1-a
- V_puits2-a
- V_gouv-a
- Tem-a
- Tem_les1-a
- Tem_les1-a
- Tem_les-a
- Tem_thib-a
- Tem_gir1-a
- Tem_gir2-a
- Tem_gir3-a
- Tem_themis-b
- Tem_toulon1-a
- Tem_toulon2-a
- Tem_lesg-a
- Tem_isis-a
- Tem_dordo-a
- Tem_primauguet-a
- Tem_dordo-a
- Arm-a
- Arm-seb1-a
- Arm-seb2-a
- Arm-seb3-a
- Arm-can-a
- Arm-can-a
- T-a
- T-b
- Z-a
- T-hel-a
- T-hel-a
- H-a
- H_1870-a
- H_1870-b
- H_1870-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_mexique-a
- H_crime-a
- H-mex-a
- H-mex2-a
- H-mex2-a
- Ch-a
- Ch-liste-a
- Per-a
- Per-a
- Per-a

























