

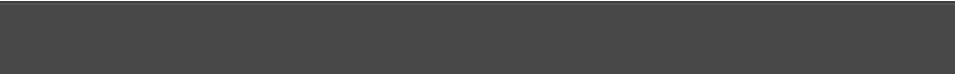
© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr
La flotte de Napoléon III - Documents

PLUS…
Le saviez-vous ?
Règle du 24ème
Afin
de
connaître
à
tout
moment
de
sa
construction
l'état
d'avancement
d'un
navire
en
construction,
le
Génie
Maritime
avait
conçu
au
début
du
19e
siècle,
une
grille
d'avancement
divisée
en
24
parties.
Cette
grille
commune
à
tous
les
bateaux,
était
connue
de
tous.
On disait par exemple que "l'Ecureuil était construit au 8/24e".
Voici cette grille :
1/24.
Formation
des
gabarits,
établissement
des
tins,
travail
des
pièces
de
quille
et
du
brion,
placement
de
la
quille
sur
les
tins,
travail
des
lisses
de tour de l'avant.
2/24.
Travail
et
érection
de
l'étrave
avec
la
contre-étrave,
travail
et
assemblage
à
terre
des
couples
de
l'avant,
confection
des
lisses
de
l'arrière.
3/24.
Travail
et
assemblage
à
terre
des
couples
de
l'arrière,
commencement de travail du système de l'arcasse.
4/24.
Confection
du
système
de
l'arcasse,
son
érection,
son
accorage,
sa
fixation
par
la
courbe
d'étambot
et
les
massifs,
distribution
sur
la
quille de tous les couples de levée.
5/24.
Érection
sur
la
quille
de
tous
les
couples
de
levée.
Perpignage,
balancement, lissage et accorage général.
6/24.
Boisage depuis l'étrave jusqu'au 3' couple de levée avant.
7/24.
Boisage depuis le 3e couple avant jusqu'au 3e arrière.
8/24.
Boisage
depuis
le
3e
couple
arrière
jusqu'aux
estains;
placement
des jambettes de voûte et allonges de tableau.
9/24.
Perçage,
dolage
jusqu'à
la
hauteur
du
pont;
ajustement
des
fourrés
ou
abouts
des
allonges,
des
clefs
entre
les
varangues.
Placement des carlingues du fond et des marsouins.
10/24.
Placement
des
serres
d'empature
et
vaigres
en
dessous
jusqu'aux paracloses, ainsi que les serres et sous-serres de faux-pont.
11/24.
Placement
des
vaigres
entre
les
sous-serres
du
faux-pont
et
les
serres
d'empature.
Travail
et
ajustement
des
guirlandes
et
courbes
d'écusson. Confection des carlingues des pieds des mâts.
12/24.
Travail
des
barrots
du
faux-pont
et
leur
placement
sur
la
serre.
Placement
des
fourrures
des
gouttières,
entremises,
barrotins,
traversins.
Formation
des
carrés
d'écoutilles.
Commencement
du
bordé
du faux-pont.
13/24.
Travail
des
baux
du
pont,
leur
introduction
à
bord,
leur
ajustement
sur
la
serre-bauquière
;
le
tout
à
son
alignement
et
bouge.
Placement du vaigre entre le pont et le faux-pont. Travail des barrotins.
14/24.
Placement
des
hiloires
renversées,
des
épontilles
de
la
cale
et
de
l'archipompe,
des
guirlandes
du
pont
et
du
faux-pont,
des
entremises,
barrotins
et
traversins
du
pont.
Formation
des
carrés
d'écoutilles
et
des
étambrais.
15/24.
Placement
des
fourrures
de
gouttières,
hiloires
et
courbes
du
pont, ainsi que les bordages entre les hiloires et les gouttières.
16/24.
Placement
des
bordages
du
milieu
du
pont
et
surbaux
d'écoutilles.
Ouverture
de
la
seconde
batterie.
Placement
des
seuillets
de sabords et bordé des murailles.
17/24.
Placement
des
préceintes
et
des
lisses
de
platbord,
platbord;
établissement des bittes et bittons.
18/24.
Confection
du
bordé
entre
la
lisse
de
platbord
et
les
préceintes,
ainsi
que
du
bordé
de
la
poupe.
Travail
de
la
guibre.
Calfatage
du
pont
et des murailles.
19/24.
Confection
de
la
moitié
du
bordé
de
la
carène.
Travail
du
perçage
pour
gournables
et
chevillage.
Érection
de
la
guibre
et
travail
de la poulaine.
20/24.
Terminé
le
bordé
de
la
carène,
la
poulaine,
le
travail
du
gournablage
et
chevillage.
Placement
des
bossoirs;
commencement
du
calfatage à l'extérieur.
21/24.
Confection
des
plateformes
des
soutes
à
pains
et
à
poudre,
et
du
bordé
du
faux-pont.
Formation
de
la
poupe
et
des
décorations.
Continuation du calfatage et commencement de la menuiserie.
22/24.
Confection
des
ameublements
de
la
cale
et
du
faux-pont;
placement
des
porte-haubans
et
leurs
chaînes.
Placement
des
mantelets. Continuation de la menuiserie.
23/24.
Accomplissement
des
travaux
de
menuiserie,
serrurerie,
vitrerie,
sculpture,
calfatage,
perçage,
chevillage,
établissement
des
pompes,
four et cuisine.
24/24.
Placement
des
ferrures
de
batterie,
des
chevilles
à
croc,
des
galoches,
oreilles
d'âne,
pentures
d'étambot
et
de
gouvernail,
accomplissement
du
lissage
et
de
divers
objets
d'armement.
Peinture.
Mise à l'eau.
SOMMAIRE
- tonnage légal
- premiers navires anglais en fer
- une glacière à bord !
- nécessité du cloisonnement
- puissance nominale
- les commissions d'expériences
- pas de croiseurs sous Napoléon III !
- embarcations réglementaires
- règlement du 24ème
Puissance nominale (chn)
Il revient à l'écossais James Watt d'avoir proposé la première unité de
puissance pour caractériser une machine à vapeur. La formule en était
simple : P = D²x V/6 (avec D diamètre du piston en pieds et V vélocité
du piston en pieds par minute).
Cette puissance nominale (chn) était en fait toute théorique, mais ce
fut le seule proposée pendant plusieurs années. Puis l'on améliora la
formule afin de définir la puissance indiquée (chi) beaucoup plus
réaliste. Cette dernière correspondait alors à environ 2 fois la puissance
nominale. Au fil des années, cet rapport augmenta pour arriver
finalement à rapport de 6.
En 1867, notre administration décida bizarrement de pérenniser la
puissance nominale avec un rapport de 1 à 4 de la puissance indiquée,
et de corriger aussi les puissances nominales des machines construites
antérieurement !
Par la suite, la mise au point de dynamomètres permit d'obtenir la
puissance effective (che). La différence entre la puissance indiquée et la
puissance effective est la puissance consommée par la machine pour se
faire tourner elle-même. Le rapport puissance effective / puissance
indiquée est stable et d'environ 0,9.
Notons encore que certains chantiers britanniques ont utilisé la
puissance nominale jusqu'en 1920, alors que la Marine Française l'a
abandonné dans les années 1870 pour la remplacer par la puissance
indiquée. Dans ces conditions les indications données par les
documents sont toujours sujettes à caution !
Une "commission d'expériences" à bord du
Redoutable en 1864.
De telles commissions étaient réunies à bord des vaisseaux pour émettre
une opinions sur des sujets proposés par le Département. Voici, à titre de
curiosité quelques uns des sujets débattus en 1864, et le sort qui leur fut
réservé :
- Doit-adopter le matelas de hamac proposé par un anglais, Mr Alliot ? -
la commission répond non.
- Un brancard a été inventé et présenté par M. Louis Joubert. Doit-il être
adopté pour les compagnies de débarquement ? - la commission répond
non
- Essai d'un nouveau système de séchage de la viande pour l'alimentation
des équipages - à l'unanimité, la commission répond non.
- Nouveau modèle de chapeau envoyé en expérience à bord du vaisseau,
doit-il être adopté ? - à l'unanimité, la commission répond non.
Tonnage légal
Ce tonnage, applicable aux bâtiments de guerre sous le Second Empire,
a été rendu légal par la loi du 12 nivôse an II, et les ordonnances du 18
nov. 1837 et du 18 août 1839.
En premier lieu, les définitions suivantes étaient adoptées pour le calcul
•
L : moyenne des longueurs mesurées du dedans de l'étrave au
dedans de l'étambot, à la hauteur du pont supérieur et de la cale.
(73,46m)
•
B : largeur intérieure sur vaigrage, mesurée à l'endroit le plus
large du bâtiment. (14,80m)
•
C : creux mesuré au-dessous du bordé de pont supérieur au
dessus du vaigrage de la cale, à côté de la carlingue, à l'endroit du
plus grand creux. (12.25m)
On applique la formule : L x B x C = T (en mètres cubes) (= 13.198,88)
On en tire :
•
un tonnage légal pour les navires propulsés à la voile : T / 3,80
(= 3.473,365)
•
le tonnage légal pour les navires à vapeur : T / 3,80 x 0,60
(= 2.084,029)
Etant entendu qu'un navire pouvait avoir deux tonnages légaux s'il était
propulsé à la voile et à la vapeur (c'était le cas du Redoutable).
Nous avons donné à titre d'exemple, en lettres rouges, les dimensions du
"Redoutable" telles que notées sur le devis d'armement.
Notons le décret du 24 mai 1873 redéfinit une nouvelle jauge applicable
aux bâtiments de guerre
Premiers navires anglais en fer
Le
premier
fabricant
d'une
coque
en
fer,
fut
un
anglais
du
nom
de
John
Wilkinson
habitant
à
Broseley
(Shropshire)
en
1787.
Ce
bateau
avait
une
taille
modeste
(70'
x
6'
8
½"
x
8")
et
pouvait
transporter
32
tonnes
de
fret
sur
la
Severn.
La
même
année,
sortait
un
navire
dont
le
fond
était
entièrement
en
cuivre,
sans
aucun
bordage
de
bois.
En
1794,
le
brigadier-général
Sir
Samuel
Bentham
construit
un
petit
bateau
entièrement en cuivre.
Il
faudra
attendre
1809
pour
que
Richard
Trevithick
et
Robert
Dickinson
déposent
le
premier
brevet
sur
l'utilisation
des
tôles
en
fer
forgé.
En
1810,
ils
proposent
au
gouvernement
anglais
de
construire
un bateau en fer, proposition que l'Amirauté refusa.
En
1815
Thomas
Jevons
construisit
un
petit
bateau
de
plaisance
tout
en
fer
qu'il
utilisa
en
mer.
Mais
le
premier
navire
commercial
ne
fut
construit
qu'en
1818
pour
le
trafic
passagers
sur
le
canal
de
"Forth
and
Clyde".
Ce
bateau
de
61'
se
nommait
le
Vulcan.
L'épopée
du
fer
était
lancée
sur
le
plan
commercial
avec
en
particulier
le
chantier
Mac
Gregor
Laird
and
Co
qui
construit
dès
1831
des
steamers
de
plus
de
100
pieds
dont
certains furent exportés vers l'Amérique.
Le
premier
navire
militaire
en
fer
fut
construit
en
1839
par
ce
chantier,
fut
le
packet-boat
Dover
pour
le
service
Douvres-Calais.
Ce
n'est
qu'en
1843
que
l'Amirauté
décide
de
former
du
personnel
pour
cette
technique.
En
1854,
elle
décide
construire
des
batteries
flottantes
en
bois
mais
entièrement
recouvertes
de
tôles
à
l'instar
des
français.
Le
premier
bâtiment
de
guerre
tout
en
fer,
sera
mis
sur
cale
en
1859.
Il
s'agit
du
Warrior (6038 tonnes, machine de 1250 chn, dim : 380' x 58' x 42' (c).
Première glacière
En juillet 1879, le transport Creuse est doté d'une glacière pour son
voyage en Nouvelle-Calédonie.
Pas de croiseurs
sous Napoléon III !
Le
terme
de
croiseur
apparaït
pour
la
première
fois
en
France
dans
la
liste
navale
du
1er
janvier
1873.
Cette
nouvelle
rubrique
comportait
20
navires
dont
6
classés
précédement
frégates et 14 classés corvettes.
Embarcations réglementaires à bord
(règlement du 13 janvier 1852)
On note dans ce règlement 34 types d'embarcations réparties en 7
classes dans 5 catégories distinctes avec leurs dimensions LxBxC :
chaloupes (10 types) : 15 x 2 x 1 m
grands canots (10) : 10 x 2 x 1 m
canots (8) : 10 x 2 x 1 m
baleinières (3) : 10 x 2 x 1 m
youyous (3) : 10 x 2 x 1 m
Nécessité du cloisonnement
"Si
les
incendies
du
Magenta
et
du
Richelieu
ont
fait
dire
aux
marins
qui
y
ont
assisté
qu'il
n'y
a
d'autre
moyen
d'éteindre
le
feu
sur
un
navire
en
bois
que
de
l'empêcher
de
se
déclarer,
l'accident
du
La
Clochèterie
coulant
en
une
heure
et
demi
dans
l'arsenal
parceque
2
prises
d'eau
de
30
cm
de
diamètre
ont
été
ouvertes,
permet
d'avancer
avec
certitude,
qu'un
bâtiment
qui
n'a
pas
de
cloisons
étanches
est
perdu
s'il
est
frappé
au-dessous
de
la
flottaison...
Si
la
substitution
du
fer
au
bois
s'impose
pour
garantir
contre
les
conséquences
du
feu,
je
crois
que
l'on
peut
affirmer
aussi,
que
le
cloisonnement
est
devenu
une
nécessité pour parer aux conséquences de l'envahissement de l'eau".
extrait d'un rapport du VA Dupetit Thouars adressé au ministre.



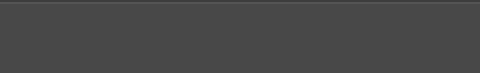
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu
eiusmod lorem
MonsiteWeb.com



- Accueil
- Index-a
- D-a
- D-a
- V-a
- V-nb
- V-nc
- V-nd
- V-na-a2-a
- V-na-a3-a
- V-na-a4-a
- V-na-a5-a
- V-na-a6-a
- V-na-a7-a
- V-na-a8-a
- V-na-a9-a
- V-na-a9-a
- Fl1860-a
- V_gouv-a
- V_puits-a
- V_puits1-a
- V_puits2-a
- V_gouv-a
- Tem-a
- Tem_les1-a
- Tem_les1-a
- Tem_les-a
- Tem_thib-a
- Tem_gir1-a
- Tem_gir2-a
- Tem_gir3-a
- Tem_themis-b
- Tem_toulon1-a
- Tem_toulon2-a
- Tem_lesg-a
- Tem_isis-a
- Tem_dordo-a
- Tem_primauguet-a
- Tem_dordo-a
- Arm-a
- Arm-seb1-a
- Arm-seb2-a
- Arm-seb3-a
- Arm-can-a
- Arm-can-a
- T-a
- T-b
- Z-a
- T-hel-a
- T-hel-a
- H-a
- H_1870-a
- H_1870-b
- H_1870-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_mexique-a
- H_crime-a
- H-mex-a
- H-mex2-a
- H-mex2-a
- Ch-a
- Ch-liste-a
- Per-a
- Per-a
- Per-a

























