

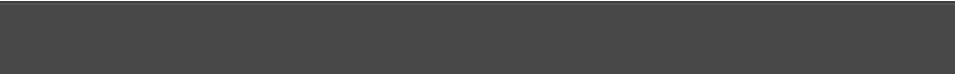
© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr
La flotte de Napoléon III - Documents

Témoignages
Charles-Henri Bonnescuelle de Lespinois (2)
… SUITE 1 (Charles-Henri de Lespinois)
Il
trouva
moyen
de
s'évader,
et
le
jour
même,
la
princesse
recevait
une
corbeille
de
fleurs,
sous
lequel
était
caché
un
œil
humain,
tout
frais,
une
langue
et
une
main
avec
cette
notice
écrite
sur
un
morceau
de
papier
»
je
t’envoie
l’œil
qui
nous
a
épié,
la
langue
qui
nous
a
dénoncé
et
la
main
qui
nous
a
désigné
à
la
justice
du
Bey.
Yousouf
»
Et
le
jeune
homme
s’empressa,
après
ce
beau
coup,
de
se
réfugier
au
consulat
de
France,
ou
M
Roche
le
consul
général,
le
mit
sous
la
protection
du
pavillon
Français
et
l’accompagna
lui-même
dans
une
embarcation
portant
le
pavillon
national
pour
s’embarquer
sur
un
navire
qui
allait
à
Bône,
tout
précisément,
en
ce
moment,
nos
troupes
faisaient
le
siège
pour
avoir
une
base
d’opérations
pour
pénétrer
dans
la
province
de
Constantine,
dont
on
voulait
s’emparer
pour
en
finir
avec
les
Barbaresques
représentés
alors
par
Achmed
Bey
de
Constantine.
Yousouf
se
présenta
au
général,
muni
d’une
lettre
d’introduction
que
lui
avait
donné
monsieur
Roche
;
sa
connaissance
du
pays,
dont
il
parlait
la
langue,
sa
bravoure,
son
intelligence
des
choses
de
la
guerre,
le
firent
bientôt
remarquer
:
il
parvint
à
s’emparer
par
surprise,
de
la
Casbah
de
Bône,
la
forteresse
qui
dominait
toute
la
ville.
Il
avait
formé
une
bande
de
sacripants
de
tous
les
pays,
de
renégats,
de
bons
à
tout,
en
un
mot.
Par
une
nuit
d’orage,
ils
grimèrent
comme
des
chats
les
remparts
qui
étaient
ébréchés
en
certains
endroits
par
suite
de
l’incurie
des
Turcs,
surprirent
les
sentinelles,
égorgèrent
tout
ce
qu’ils
rencontrèrent
et
firent
se
rendre
le
reste
des
défenseurs
terrifiés
par
ce
coup
d’audace
;
A
la
pointe
du
jour,
le
drapeau
Français
était
hissé
sur
la
forteresse
et
l’armée
entrait
dans
la
ville.
Ce
fut
le
commencement
de
la
fortune
militaire
de
Yousouf,
on
le
nomma
officier
à
titre
indigène,
et,
on
doit
le
dire,
chaque
nouveau
grade
qu’il acquit, fut dû à un coup d’éclat.
Lorsque
j’arrivais
à
Alger
en
1851,
il
venait
d’être
nommé
général
de
brigade
au
titre
indigène,
après
la
prise
de
Laghouat
en
1853,
il
fut
nommé
au
titre
Français.
Il
est
mort
après
la
guerre
de
1870
à
Montpellier
ou il commandait la division.
1851- 1855
C’est
pendant
les
quatre
années
que
j’ai
passées
en
Algérie
que
Mac
Mahon
était
dans
tout
l’éclat
de
sa
célébrité
de
général
Africain
;
que
le
général
Pélissier
commandait
la
province
d’Oran,
la
plus
turbulente,
la
plus
difficile
à
contenir
à
cause
du
voisinage
de
la
frontière
du
Maroc,
qui
offrait
toutes
facilités
de
refuge
et
de
ravitaillement
aux
tribus
qui
s’insurgeaient
à
la
voix
de
divers
agitateurs
politico
religieux,
tels
que
Bou
Maza,
le
père
à
la
chèvre
;
Bou
Barghla,
le
père
à
la
mule
etc.
J’aurais
voulu
voir,
à
la
place
de
ces
vaillants
généraux,
messieurs
les
gouverneurs
et
résidents
civils
que
les
gouvernement
d’aujourd’hui
veulent
mettre
à
leur
place
dans
les
colonies
en
train
d’être
conquises..
Bien
certainement
nous
ne
serions
plus
en
Algérie
;
les
arabes
nous
auraient
rejetés
à
la
mer.
Nous
en
avons
un
exemple
frappant
aujourd’hui
à
Madagascar.
Sans
la
présence
et
la
gentillesse
et
la
justesse
de
vue
du
général
Gallieni,
tous
les
Français
qui sont dans l’île seraient bien prêts d’être égorgés.
Ce
fut
à
cette
époque
que
le
professeur
Jacubowitz
de
Saint-
Pétersbourg
présenta
à
l’académie
des
sciences,
un
travail
des
plus
remarquables
sur
les
fonctions
du
cerveau.
C'est
un
travail
de
longue
haleine
et
qui
a
demandé
un
grand
nombre
d’années
d’observations
minutieuses
et
d’autopsies
très
nombreuses,
car
il
repose
sur
l’observation
de
vingt
cinq
mille
coupes
du
cerveau
dans
ses
diverse
parties
;
Il
avait
commencé
par
réunir
dans
une
grande
salle
clinique
un
certain
nombre
de
malades
atteints
de
maladie
incurables.
Outres
les
observations
cliniques,
il
notait
avec
soin,
sur
un
registre
ad
hoc,
le
degré
d’intelligence
qu’il
supposait
à
chaque
sujet
observé,
d’après
les
conversations
qu’il
entamait
avec
lui
sur
divers
objets
de
manière
à
pouvoir
lui
donner
une
moyenne,
un
coefficient
d’intelligence
quand
un
sujet
mourait,
il
préparait
son
cerveau,
et
le
soumettait
à
des
coupes
en
tranches
d’une
épaisseur
déterminée
d’avance,
et
il
observait,
à
l’aide
du
microscope
la
substance
cérébrale
plus
ou
moins
riche
en
cellules
dans
un
espace
d’un
centimètre
carré.
Il
avait
fait
et
répété
ces
observations
sur
un
très
grand
nombre
de
sujets,
et
ce
ne
fût
que
quand
il
eu
rassemblé
un
nombre
immense
de
renseignements
microscopiques,
il
en
vint
à
soutenir
cette
thèse,
que
toutes
les
localisations
des
facultés
cérébrales
n’ont
donné
que
des
résultats
faux
dans
les
systèmes
de
Gall
et
autres
physiologistes
;
que
pour
lui,
l’intelligence
gît
dans
les
cellules
cérébrales,
et
qu’elle
est
plus
ou
moins
vive
et
ouverte
selon
la
quantité
de
cellules
dont
un
cerveau
est
doué
;
que
la
multiplication
des
cellules
cérébrales
est
subordonnée
à
l’exercice
régulier
et
normal
de
l’intelligence
qui
s’atrophie
et
diminue
parallèlement avec la diminution du nombre des cellules.
Doctrine
absolument
matérialiste,
qui
peut
faire
comparer
le
cerveau
à
une
chaudière
tubulaire
des
machines
à
vapeur,
dont
la
surface
augmente avec le nombre des tubes.
Vers
la
mi-décembre
1853,
nous
avions
à
bord
comme
lieutenant,
l’enseigne
de
vaisseau
de
Chabannes
du
Peux,
un
charmant
garçon
qui
dessinait admirablement.
Il
me
fit
poser,
et
fit
mon
portrait
tel
que
j’étais
à
l’âge
de
31
ans,
Il
était
d’une ressemblance parfaite.
Je
m’empressai
de
le
faire
encadrer,
et,
profitant
du
passage
à
Alger
d’un
navire
de
l’Etat
qui
allait
désarmer
à
Toulon,
je
l’envoyai
à
ma
femme
avec
une longue lettre.
En
cette
même
année
1853,
on
était
en
train
de
démolir
le
fort
qui
défendait
Alger
du
coté
de
l’Ouest,
et
qui
était
situé
en
dehors
des
anciens
remparts
qui
s’ouvraient
dans
cette
direction
par
la
porte
Bab-El-Oued.
Il
y
avait
une
légende
qui
avait
été
découverte
dans
des
chroniques
Beylicales,
déposées
à
la
bibliothèque
d’Alger
et
que
monsieur
Berbrugger,
l’érudit
bibliothécaire, avait traduites et publiées.
Dans
cette
légende
il
était
dit
qu’un
bey
de
l’époque
de
l’occupation
d’Oran
par
les
Espagnols,
c'est-à-dire
vers
le
XV
siècle,
ayant
capturé
un
Maure
d’Oran
qui
avait
embrassé
le
catholicisme
entre
les
mains
de
moines espagnols, lui fit subir le supplice suivant.
On
était
en
train
de
bâtir
les
substructures
de
ce
fort
à
l’aide
de
blocs
de
béton
que
l’on
formait
sur
place.
Un
jour
que
le
Bey
assistait
à
ces
travaux,
il
vint
à
se
souvenir
de
ce
prisonnier,
qu’on
appelait
Géronimo
depuis
son
baptême
:
il
ordonna
qu’on
le
lui
amena,
et
lui
intima
l’ordre
d’abjurer
cette
religion
des
Roumis,
et
sur
le
refus
répété
de
ce
malheureux,
il
lui
fit
lier
les
pieds
et
les
mains,
le
fit
étendre
de
tout
son
long
dans
le
grand
cadre
qui
servait
de
moule
aux
blocs
de
béton,
et
le
fit
recouvrir
de
béton
et
de
mortier,
on
continua
à
bâtir
les
fondations
du
fort
sur
ce
bloc
qui
contenait Géronimo.
Or
en
1853,
les
officiers
d’artillerie,
guidés
par
les
indications
que
leur
avait
donné
Monsieur
Berbrugger,
firent
partir
un
pétard
qui
ouvrit
latéralement
le
bloc
ou
été
enfermé
le
pauvre
diable
depuis
environ
trois
cent
ans,
et
on
pu
voir
le
squelette
dans
la
position
forcée
où
l’avait
mis
la
pression du béton.
Mais
il
y
avait
des
contradicteurs,
des
incrédules
touchant
cette
légende,
ce
qui
donna
lieu
à
la
formation
d’une
commission
présidée
par
le
gouverneur
général
Randon
qui
était
protestant,
et
où
était
entré
l’évêque d’Alger, Monseigneur Pavie et tutti quanti.
Un
employé
des
postes
et
trésor
de
l’armée
qui
était
très
malin
et
spirituel
(il
était
borgne)
s’empara
de
la
chose
et
fit
une
complainte
qui
a
parcouru
toute
l’Algérie,
et
dont
on
m’adressa
une
copie
que
je
reproduis
ici, avec les noms des membres de la commission.
Il
en
résulta
de
toutes
ces
histoires,
de
ces
commissions,
de
ces
interprétations
de
textes
plus
ou
moins
hyperboliques,
que
se
fût
Monseigneur Pavy qui l’emporta.
On
sépara
avec
précautions
infinies
le
bloc
de
béton
renfermant
le
squelette
des
autres
blocs
qui
l’entouraient
et
au
jour
convenu,
l’évêque
avec
tout
son
clergé
et
une
procession
aussi
longue
que
les
Panathénées
du
Parthénon
d’Athènes,
vint
prendre
possession
de
la
géode
avec
son
contenu
pour
le
faire
transporter
en
grande
pompe
dans
la
cathédrale
d’Alger, où on le voit encore.
Il
avait
eu
l’habilité
d’obtenir
préalablement
du
Pape
Pie
IX
non
point
la
canonisation,
mais
le
titre
de
bienheureux
pour
cette
pauvre
victime
de
la
cruauté d’un Bey d’Alger.
1854
Dans
l’été
de
1854,
comme
nous
faisions
avec
mon
navire
l’Euphrate,
les
courriers
d’Oran
à
Cadix
faisant
escale
à
Djemma,
Gaza,
Gibraltar,
et
Tanger,
je
fis
connaissance
du
capitaine
Chanzy,
le
chef
du
bureau
arabe
de
Clemcen
en
ce
moment,
et
qui,
plus
tard,
en
1870,
dans
la
guerre
contre
les
allemands
s’illustra
comme
général
en
chef
de
l’armée
de la Loire.
C’est
également
à
Oran
que
je
fus
présenté
au
général
Pélissier
qui,
plus
tard,
prit
Sébastopol,
et
qui,
malheureusement,
est
mort
avant
notre
guerre
désastreuse
avec
la
Prusse.
C’était
un
esprit
abrupt,
primesautier,
énergique et ne craignant pas la responsabilité.
S’il
avait
été
à
la
place
de
Mac
Mahon
dans
l’armée
levée
à
Paris,
cela
eut
marché
autrement,
car
il
ne
se
serait
pas
laissé
entraîner
par
des
raisons
dynastiques
a
se
faire
enfermer
dans
Sedan
:
ou
bien,
si
à
la
place
de
Bazaine,
il
eut
commandé
cette
belle
armée
de
Metz
qui
infligea
de
si
rudes
défaites
aux
Allemands
sous
les
murs
de
cette
ville,
ils
les
auraient
chassés de France ! et nous n’aurions pas été démembrés !.
C’est
à
cette
époque
que
commencèrent
à
défiler
de
l’Algérie
vers
l’Orient
ces
vieilles
troupes
d’Afrique
qui
venaient
se
couvrir
de
gloire
en
Crimée et sous les murs de Sébastopol,
Mais
quelle
hécatombe,
bon
Dieu
!
que
de
généraux,
d’officiers
supérieurs
et
subalternes
que
j’ai
connus,
à
qui
j’ai
serré
la
main
à
leur
départ
et
qui
ont
laissé
leurs
os
sur
la
terre
de
Chersonèse
;
Et
je
ne
parle
pas
des
pauvres
soldats
!!!
bien
que
pour
ma
part,
Français,
nous
avons
perdu
400
000
hommes,
les
Anglais
autant
;
les
Russes
600
000
;
quant
aux
turcs
on
n’a
jamais
pu
arriver
à
énumérer
leurs
pertes
;
tout
ce
que
l’on
peut
dire
c’est
qu’il
mouraient
comme
des
mouches
;
et
tout
cela
pour
suivre
une
politique
néfaste,
contraire
à
tous
nos
intérêts,
uniquement
pour
faire
le
jeu
de
l’Angleterre
qui
nous
a
remerciée
de
la
façon
que
nous
savons
tous,
même
en
ce
moment
actuel
;
Ce
sont
et
ce
seront
toujours
nos ennemis les plus intimes et les plus déloyaux.
Quoiqu’il
en
soit,
un
beau
jour,
l’Euphrate
reçut
l’ordre
de
rallier
le
port de Toulon après un séjour de quatre ans en Algérie.
Dans
les
derniers
temps
ma
femme
et
mes
deux
fils
étaient
venu
me
rejoindre
à
Alger,
et
après
un
séjour
de
six
mois
nous
rentrâmes
à
Toulon,
ou
je
débarquai
de
l’Euphrate
et
fus
affecté
à
la
prévôté
de
l’hôpital
du
Bagne.
Mais
ce
ne
fut
pas
pour
longtemps,
car
un
beau
jour
je
fus
désigné
pour
aller
embarquer
à
Constantinople
sur
la
frégate
»
l’Algérie
»
en
remplacement
de
Duprat,
l’auteur
de
l’Opéra
de
Pétrarque,
qui
était
convalescent
de
typhus
et
qui
rentrait
en
France,
après
un
séjour
de
quelques
mois
à
l’île
de
Calechi
(île
des
princes)
dans
la
mer
de
Marmara,
ou
était
mouillée
la
frégate
jusqu’à
ce
que
son
équipage
se
fut
remis
de
l’épidémie
de
typhus
qui
avait
régné
à
bord
et
fait
pas
mal
de
victimes,
nous reçûmes l’ordre de rallier Toulon.
En
route
et
par
prudence,
je
fis
acheter
de
grandes
quantités
d’oranges,
de
citrons
et
œufs
pour
l’équipage
à
Messine,
car
j’avais
déjà
des
symptômes
de
scorbut
chez
quelques
hommes
;
tous
étaient
profondément
anémiés,
et
bien
certainement,
si
je
n’avais
pas
pris
ces
précautions,
nous
serions
restés
en
route.
Pris
par
les
calmes
dans
les
parages
des
îles
Lipari,
nous
étions
à
quatre
milles
à
peine
du
Stromboli,
que
je
tombai
malade
du
typhus
heureusement,
je
ne
fus
pas
assez
profondément
atteint
pour
ne
pas
pouvoir
me
mouvoir,
je
me
faisais
habiller
par
mon
domestique
et
j’allai
me
placer
avec
mon
aide,
sous
la
ralingue
de
la
brigantine,
et
je
ramassais
le
plus
possible
d’oxygène
dans
mes poumons ;
Je
suis
convaincu
que
c’est
à
cela
que
je
dois
de
n’avoir
pas
vu
s’aggraver
mon
état
;
pourtant
quand
nous
arrivâmes
à
Toulon,
je
pouvais
à
peine
me
soutenir
et
je
restai
alité
à
la
maison
;
Grâce
à
un
bon
régime
et
au
changement
d’air,
je
fus
en
état
de
suivre
la
destination
de
la
frégate
qui
devait aller désarmer à Brest.
Je
restai
trois
mois
à
faire
du
service
à
l’hôpital
de
Clermont-Tonnerre,
et
je
rentrai
à
Toulon
à
la
fin
de
l’année.
Comme
j’avais
fini
mon
temps
d’embarquement,
j’étais
le
dernier
à
partir.
Et
sur
ces
entrefaites,
la
prévôté
de
l’hôpital
de
Saint-Mandrier
étant
devenue
vacante,
je
fus
désigné
pour
cette
fonction,
sous
les
ordres
de
Mr
Jules
Roux,
qui
était
alors second médecin en chef, chargé du service général de l’hôpital ;
Comme
j’étais
habituellement
son
prévôt
quand
j’étais
à
terre,
sur
sa
demande,
il
savait
qu’il
pouvait
compter
sur
moi,
et
il
ne
se
gênait
pas
pour brûler le service, pas mal, souvent.
Seulement,
quand
quelque
chose
d’insolite
arrivait,
je
le
tenais
au
courant
et
je
l’avertissais
;
mais
;
quoique
j’y
trouvasse
mon
profit
pour
mon
instruction
clinique,
cela
quelquefois
me
gêner,
ayant
sur
le
dos
la
responsabilité de 400 malades.
Enfin
cela
marchait
bien,
car
le
nombre
des
malades
diminuait
tous
les
jours.
Si
bien
qu’au
mois
de
septembre
1857,
le
directeur
du
service
de
santé
décida
de
fermer
l’hôpital
et
d’évacuer
le
peu
de
malades
qui
restaient, à l’hôpital principal en ville.
Il y avait tempête de calme pathologique.
Je
quittai
donc
la
prévôté
et
me
trouvai
le
premier
à
embarquer.
Heureusement
pour
moi,
le
petit
aviso
garde
pêche
»
le
Rôdeur
»
devenait
vacant,
et
je
fus
embarqué
sur
ce
petit
navire
avec
lequel
j’ai
visité
tous
les
ports
de
la
côte
sud
de
la
France,
depuis
Nice
jusqu’à
Port-Vendres,
passant par Marseille.
Nous
fîmes
d’abord
le
service
entre
ce
port
et
Antibes,
et
au
commencement
de
1858,
nous
allâmes
nous
amarrer,
bord
à
quai
à
St
Jean,
prés
de
la
santé,
à
Marseille,
je
revis
là
l’excellent
et
vieil
ami
de
mon
père,
Mr
Giscaro,
qui
se
risqua
à
venir
visiter
ce
qu’il
appelait
plaisamment
mon
yacht
;
toujours
bon
et
affectueux,
il
me
retenait
quelquefois
à
déjeuner,
et
nous
parlions
des
souvenirs
d’antan
et
de
la
Castellane,
et
de
tous les membres de la famille.
Quelque
fois
ma
mère
et
ma
femme
venaient
me
voir,
alors
il
saisissait
cette
occasion
de
nous
réunir
tous
à
sa
table
;
il
supportait
avec
un
courage tout philosophique la perte qu’il avait faite.
D’abord
de
sa
charmante
fille,
puis,
peu
de
temps
après,
de
sa
femme
;
et
il
manifestait
déjà
le
désir
de
retourner
à
Toulouse,
son
pays
natal,
ou
il
avait un neveu, docteur en médecine, projet qu’il réalisa plus tard.
Je
reçu
de
lui,
plus
tard,
en
1864,
une
lettre
touchante
dans
laquelle
il
me
remerciait
d’avoir
pensé
à
lui,
en
lui
faisant
partager
avec
mon
père
la
dédicace
de
ma
thèse
pour
le
doctorat,
c’était
de
toute
justice
selon
moi
;
et
ensuite,
il
me
semblait
en
faisant
cela,
adresser
un
nouvel
hommage
à
la mémoire de mon père dans la personne de son ami.
Le
mois
de
mai
arrivant,
le
commandant
du
«
Rôdeur
»
décida
de
commencer
à
exercer
la
surveillance
de
la
pêche
dans
le
secteur
Marseille,
Port-Vendres.
Et
naturellement
les
premiers
ports
que
nous
visitâmes
fut,
Port
de
Bouc,
les
Martigues,
la
nouvelle
Venise
et
l’étang
de
Berre
;
C’étaient
des
pays
d’autant
plus
curieux
à
visiter
qu’ils
n’avaient
pas
subi
encore
le
niveau
égalitaire
que
les
voies
ferrées
promenant
sur
les
localités
qu’elles
desservent.
Ils
avaient
conservé
leur
couleur
locale,
cette
saveur
spéciale
à
chaque
terroir,
ainsi
que
les
mœurs
et
les
coutumes
anciennes
;
aussi
il
fallait
voir
le
bon
sang
que
se
faisait
notre
jeune
commandant
quand,
causant
service
avec
le
syndic
des
gens
de
mer,
il
lui
faisait
des
questions
sur
les
habitudes
et les coutumes du pays.
Un
jour
entre
autres,
qu’il
lui
demandait
pourquoi
il
y
avait
un
si
grand
nombre
de
jeunes
filles
qui
n’étaient
pas
mariées
et
qui
pourtant
étaient
enceintes,
alors
le
bonhomme
de
lui
expliquer
que
les
jeunes
gens
n’épousaient
que
des
filles
à
la
preuve….
Mais
comment
?
À
la
preuve
de
quoi
?...
eh
!
Commandant,
c’est
que
lorsqu’elles
sont
enceintes,
c’est
preuve
qu’elles
sont
bonnes
!
Ah
très
bien
!
Je
comprends
;
de
cette
manière,
ils
sont
surs
d’avoir
des
enfants
!
Oui,
commandant…
et
quelle
envie
de
rire
nous
avions
!
Notre
charmant
commandant
!
C’était
Doudart
de
LaGrée,
alors
lieutenant
de
vaisseau,
élève
de
l’école
polytechnique,
passionné
pour
les
arts
et
très
fort
en
archéologie.
Il
déchiffrait
les
inscriptions
romaines
et
grecques
avec
la
plus
grande
faculté
;
avec
cela
modeste et très bon.
Il
est
mort
capitaine
de
frégate,
commandant
en
chef
l’exploration
du
Haut
Mékong,
d’une
maladie
de
foie
d’origine
paludéenne.
Il
a
été
le
précurseur
des
conquérants
du
Tonkin,
et
avait
devant
lui
l’avenir
le
plus
brillant
;
Il
repose
sous
un
arbre
dans
le
haut
Yunnan,
au
nord
du
Tonkin,
et
son
cœur
est
déposé
dans
un
monument
qui
lui
a
été
élevé
dans
sa
ville
natale prés de Grenoble.
Nous
avons
fait
là
un
véritable
voyage
de
touristes.
Nous
avons
vu
Narbonne,
vieille
capitale
de
la
Narbonnaise
Romaine,
dont
le
musé
est
rempli
de
sculptures
anciennes,
entre
autres
un
buste
en
marbre
blanc
d’Agrippine mère de Néron, qui est un véritable chef d’œuvre.
En
faisant
les
tranchées
pour
le
chemin
de
fer
du
midi,
on
a
mis
à
jour
toutes
les
pierres
sculptées
d’un
ancien
arc
de
triomphe
qu’on
pourrait
reconstruire si on les rassemblait et rajustait avec soin.
La
cathédrale
St
Just
de
Narbonne
est
un
beau
et
hardi
spécimen
de
l’art
gothique,
et
les
traditions
Romaines
y
sont
restées
si
vivaces
qu’on
vous
parle
de
tel
ou
tel
personnage
Romain,
tel
proconsul
ou
tribun
comme
si
on
les
avait
vus
hier
;
et
l’on
a
coutume
d’attribuer
à
Jules
César
une
foule
de
choses
qui
n’existent
que
dans
l’imagination
féconde
des
tartarins
du
pays.
De
Narbonne
à
Sète,
il
n’y
a
qu’un
pas
;
et
là,
comme
le
navire
y
était
moins
exposé
qu’ailleurs
dans
son
port
bien
fermé,
après
avoir
visité
tous
les
musées
et
les
diverses
fabriques
du
pays,
entre
autres
celles
de
vin
de
Champagne,
nous
prenions
le
chemin
de
fer
et
nous
allions
visiter
Montpellier,
Nîmes
etc.
L’ancienne
Nemausus
était
surtout,
pour
nous,
l’objet
d’une
attraction
toute
spéciale,
à
cause
des
nombreux
spécimens
de
l’art
antique
qu’elle
vous
présente
à
chaque
pas,
mais
encore
à
cause
de
l’élégance
de
l’architecture
des
maisons
qui
se
ressent
de
l’étude
de
l’antique.
Les
arènes,
la
maison
carrée,
la
fontaine
et
les
bains
Romains,
la
tour
Magne,
les
vieux
temples
en
ruines,
tout
cela
nous
attirait,
et
avait
pour
nous
un
charme
infini,
surtout
avec
un
Cicérone
comme
cet
excellent
de
Lagrée !
Nous
continuâmes
à
visiter
tous
les
ports
de
la
côte
et
entre
autres
Aigues
Mortes,
célèbre
par
le
choix
que
fit
St
Louis
de
cette
ville,
comme
port
d’embarquement
de
sa
croisade
en
Egypte.
C’est
lui
qui
fit
bâtir
cette
énorme
tour
qui
domine
tout
le
pays
de
toute
sa
hauteur
de
trente
mètres.
Cette
petite
ville
si
misérable
par
sa
situation
au
milieu
des
bourdigues
et
des
marais
salants
du
delta
du
Rhône,
dont
les
habitants
minés
par
la
fièvre
avaient
conservé
tous
les
caractères
éthiques
des
Sarrasins
dont
ils
descendent presque sans mélange,
Cette
ville,
dis
je,
est
très
curieuse
à
voir
à
cause
de
sa
ceinture
complète
de
remparts
à
mâchicoulis
avec
des
tours
à
créneaux
de
distance
en
distance,
ouvrage
de
Philippe
le
Hardi,
fils
de
St
Louis
et
construit
sur
le
modèle
de
la
ville
de
Damiette,
en
Egypte,
à
cette
époque,
La
tour
de
constance,
bâtie
par
Saint
Louis
est
antérieure
de
plusieurs
années
à
ces
remparts,
qui
sont
soigneusement
entretenus
par
un
garde
du
génie
nommé
à
cet
effet
par
l’état,
car
ils
ont
été
classés
comme
monument
historique.
Nous
avons
observé
à
Aigues
mortes
une
seconde
édition
des
mœurs
et
coutumes
des
Martigues;
une
passion
effrénée
pour
les
ferrades
et
les
jeux
de
taureaux
de
la
Camargue
qui,
parait-il,
sont
plus
farouches
que
dans
tout
le
reste
du
delta
(sans
doute
pour
faire
honte
aux
filles
du
pays
!!)
avec
çà,
un
fond
de
religion
et
d’idées
chevaleresques,
des
passions
vives
et
des
vendettas
comme
en
corse,
des
idées
généreuses
et
un
sentiment
de
liberté
indomptable,
surtout
chez
les
pâtres
des
manades
de
chevaux et de bœufs.
Nous
avons
laissé
dans
le
pays
un
souvenir
profond.
C’était
l’époque
du
mois
de
Marie,
et
on
n’avait
personne
pour
accompagner
avec
les
orgues.
Il
arriva
que
pilotés
dans
le
pays
par
un
receveur
de
l’enregistrement,
en
visitant
l’église,
il
nous
raconta
que
les
desservants
de
la
paroisse
étaient
navrés
de
ne
plus
entendre
les
sons
de
l’orgue
(l’abbé
qui
en
joué
ayant
été changé).
Nous
montâmes
dans
la
galerie,
j’ouvris
les
registres
et
je
priai
le
commissaire
de
souffler,
et
je
me
mis
à
jouer
ce
qui
me
passa
par
la
tête.
Sur
ces
entrefaites
passe
un
abbé
qui
reste
figé
au
sol
en
entendant
mugir
les
orgues
;
il
monta
et
me
prie
avec
instance
d’accompagner
les
cantiques
des choristes au mois de Marie.
Je
lui
fais
observer
que
je
ne
sais
pas
les
airs
que
chantent
ces
demoiselles
:
«
qu’à
cela
ne
tienne,
monsieur
le
docteur
!
Attendez
moi
un
instant
je
vais
revenir
»
Il
sort
et
s’en
va
recruter
les
choristes
aux
quatre
coins de la ville.
En
véritables
filles
d’Eve
poussées
par
la
curiosité,
elles
arrivent
toutes,
et
se
rangent
en
cercle
autour
de
moi
;
il
y
en
avait
de
charmantes
;
hum
!!
Enfin
je
prie
celles
qui
faisaient
le
chant,
de
chanter
leur
partie
dans
le
ton
qu’elles
prenaient
habituellement
;
Bref
!!!
J’attrape
le
ton,
à
mon
signal
on part, l’accompagnement est empoigné par moi à la volée.
Elles
trouvent
cela
joli
;
l’abbé
nage
dans
le
septième
ciel…
nous
passons
en
revue
et
répétons
de
cette
manière
tous
les
cantiques
qu’elles
avaient
l’habitude
de
chanter,
et
on
me
donne
rendez
vous
pour
le
soir.
Quelle
rumeur
!
Qu’elle
renommée
enthousiaste
circule
dans
la
ville
!
Un
officier
de marine va faire jouer les orgues et accompagner le mois de marie !!.
Le
soir
toute
la
ville
était
dans
l’église,
et
ceux
qui
n’avaient
pas
pu
trouver
de
place
dans
l’intérieur
du
temple
écoutaient
dehors
et
faisaient
queue
jusque
devant
la
statue
de
Saint
louis
qui
est
face
à
la
cathédrale.
Cela
marcha
comme
sur
des
roulettes,
malgré
les
appréhensions
que
je
causais
à
notre
excellent
commandant
qui
avait
une
peur
bleue
que
je ne fisse quelque frasque.
C’était
un
vendredi
;
Le
curé
vint
le
lendemain
à
bord
me
remercier
et
remercier
aussi
le
commandant
l’invitant
à
assister
à
la
grand’messe
le dimanche.
Il
reçut
également
la
visite
de
toutes
les
autorités
;
Tout
le
monde
s’empressait
de
nous
saluer,
de
nous
sourire,
de
nous
faire
des
politesses
;
Voyant
cela,
le
commandant
nous
dit
«
Parbleu
!
Voila
de
braves
gens
!
Et
je
veux
que
la
fête
soit
complète
!
»
Il
fut
convenu
avec
le
curé
que,
le
dimanche,
je
jouerai
des
orgues
à
la
grand’messe,
et
que
le
soir,
on
danserait
sur
le
quai
entre
les
remparts
et
le
Rodeur
qui
fut installé en conséquence.
On
avait
tendu
des
pavillons
reliés
entre
eux,
des
remparts
aux
deux
mats
du
navire.
Les
matelots
avaient
nettoyé
et
battu
le
terrain
en
cet
endroit.
Le
pont
du
Rodeur
entre
les
deux
mats
avait
été
converti
en
buffet
ou
il y avait des masses de gâteaux et des liquides de toute espèce.
Le
tambour
de
la
ville
avait
reçu,
avec
la
pièce
du
commandant,
l’ordre
de
tambouriner
dans
toute
la
ville,
que
le
Rodeur
donnait
une
soirée dansante aux habitants.
Le
dimanche
guidé
par
un
abbé
qui
m’avertissait
quand
il
fallait
jouer,
je
fis
entendre
aux
habitants
d’Aigues-Mortes
des
airs
de
tous
les
grands
maîtres,
la
prière
de
Moïse
à
l’élévation
et
enfin
une
marche
guerrière de Verdi à la fin.
Oh
jamais
on
ne
pourra
se
figurer
l’effet
produit
par
un
virtuose
improvisé
et
de
ma
force
:
peu
s’en
fallut-il
qu’on
ne
m’applaudit
comme
au
théâtre.
Les
desservants
de
la
paroisse
étaient
aux
anges,
et
le
commandant
lui-même,
qui
trônait
au
banc
des
marguilliers
en
tenue,
sabre
et
épaulettes,
regardait
de
temps
en
temps
de
coté,
là
haut
aux
orgues,
comme
pour
se
rendre
compte
que
c’était
bien
moi
;
je
le
voyais
dans
le
petit
miroir
qui
donne
vue
sur
l’autel
et
les
environs
et qui est placé au-dessus des claviers.
Plus
tard
vint
le
mois
de
Marie,
et
enfin
après
le
dîner,
en
avant
les
plaisirs
profanes
…
sur
lesquels
le
bon
curé
ferma
les
yeux,
supposant
avec
raison,
comme
Saint
Augustin,
que
la
corde
d’un
arc
ne
doit
pas
être toujours tendue.
Ce
fut
une
soirée
fulgurante,
inoubliable
!
Il
est
dans
l’habitude
à
Aigues
Mortes,
comme
du
reste
en
Espagne,
que
l’on
prend
une
danseuse pour tout le bal durant.
Et
je
dois
dire,
qu’il
s’établit
en
cette
soirée
des
intimités
qui
donnèrent
un
peu
de
souci
à
notre
cher
commandant,
car
nous
avions
un
petit
équipage
très
gentil,
assez
élégant
et
en
grande
partie
composé de provençaux.
Pour
moi
j’avais
tout
simplement
invité
la
soprano
des
choristes
qui
était
toute
orgueilleuse
d’être
la
danseuse
du
docteur.
Cela
fit
qu’elle
requit,
selon
la
coutume
du
pays
;
un
surnom
que
probablement
elle
porte
encore
;
ses
compagnes
ne
l’appelèrent
plus
que
la
Majour
(on
appelle le médecin, Major).
On
dansa
presque
jusqu’au
jour,
et,
sitôt
que
le
pont
fût
nettoyé,
les
pavillons
et
tous
les
appareils
remis
en
place,
le
commandant
donna
l’ordre
d’allumer
les
feux
;
la
nouvelle
de
notre
départ
se
répand
dans
la
ville
comme
une
traînée
de
poudre
;
et
lorsque
le
Rodeur
avec
son
panache
de
fumée
défila
majestueusement
devant
les
remparts
de
la
vieille
cité,
on
vit
presque
toute
la
population
crier
avec
exaltation
«
vive
le
docteur
!
Vive
le
docteur
!!
Et
toutes
ces
charmantes
filles
qu’on
laissait
sur
le
goût
de
ce
plaisir
impromptu
qu’on
leur
avait
procuré,
s’essuyaient
avec
leur
mouchoir
leurs
beaux
yeux
noirs
baignés
de
larmes !
Nous
visitâmes
encore
Agde,
Collioure,
Port-Vendres
ou
nous
fîmes
honneur
aux
vins
délicieux
de
Rivesaltes,
de
Cospron
etc.
et
enfin
nous
rentrâmes directement à Marseille.
Sur
ces
entrefaites,
le
commandant
reçut
l’ordre
de
rentrer
à
Toulon,
et,
comme
mon
temps
d’embarquement
était
terminé,
je
débarquai
pour
le
service
à
l’hôpital
du
bagne
comme
prévôt
avec
Mr
Jules Roux.
Rien
de
particulier
dans
ce
service,
si
ce
n’est
qu’il
y
eut
une
épidémie
de
typhus
parmi
les
condamnés,
et
que
la
salle
des
fiévreux
regorgeait
de
malades
jusque
vers
notre
coté
affecté
aux
blessés
et
aux incurables.
1859
Au
printemps
de
1859,
je
fus
embarqué
sur
le
vaisseau
le
Napoléon.
La
plupart
du
temps
en
rade
d’Hyères,
exercices
à
feu,
expériences
sur
de
nouveaux
moyens
de
destruction
qui
sont
d’après
les
philosophes
de
tous
les
pays,
le
critérium
d’une
civilisation
plus
ou
moins avancée.
Mais
le
vieil
adage,
si
vis
pacem
parabellum,
reçut
son
application
en
ce moment ou personne ne s’attendait à la guerre.
Tout
d’un
coup
la
nouvelle
se
répand
que
nous
avons
déclaré
la
guerre
à
l’Autriche
et
que
les
plaines
de
la
Lombardie
sont
destinées
à
devenir, à nouveau, le champ clos ou se joue la destinée de l’Italie ;
La
déclaration
de
guerre
coïncida
avec
l’achèvement
de
la
voie
ferrée
entre
Marseille
et
Toulon.
Cette
dernière
ville
devint
en
peu
de
jours un vaste camp où se succédait des troupes de toutes les armes.
Outre
l’escadre
de
guerre
qui
était
destinée
à
les
protéger,
une
énorme
quantité
de
navires
de
commerce,
mobilisés
par
l’état,
venait
charger
du
matériel,
des
munitions
des
vivres,
des
troupes
qui
se
dirigeaient le plus rapidement possible sur le port de Gènes.
D’un
autre
coté,
les
voie
ferrées
par
Lyon,
versaient
jusqu’au
pied
des
Alpes,
les
troupes
qui
devaient
agir
par
le
nord
de
l’Italie.
Les
navires
de
guerre
transportaient
également
des
troupes
avec
une
grande célérité.
Le
Napoléon
et
la
Bretagne
transportèrent
à
eux
seuls,
presque
une
division
entière,
avec
ses
généraux,
aide
de
camps,
chevaux
etc.
C’était
un
enthousiasme
indescriptible,
surtout
quand
toutes
ces
belles
troupes
débarquaient
à
Gènes
;
le
génie
superlativement
laudatif
du
peuple Italien se donnait carrière pour acclamer les libérateurs !
Hélas
!
Depuis,
cela
s’est
bien
refroidi,
et
le
roi
Humbert
a
par
trop
vite
oublié,
que
vingt
mille
Français
dorment
leur
dernier
sommeil
dans les plaines de la Lombardie après lui avoir donné sa couronne.
Quant
au
Napoléon,
de
concert
avec
l’Algésiras
portant
le
pavillon
de
l’amiral
Jurien
de
la
Gravière,
il
fut
dirigé
avec
trois
frégates
dans
l’Adriatique
pour
bloquer
l’escadre
Autrichienne
et
faire
une
diversion
sur les cotes de la Dalmatie et de la Vénétie.
Nous
étions
mouillés
devant
Venise
à
dix
mille
en
mer
environ,
après
avoir
capturé
en
route
une
certaine
quantité
de
navires
Autrichiens,
qui avaient été surpris par la déclaration de guerre.
Plusieurs
revenaient
d’Angleterre
bondés
de
charbon
de
Cardiff
et
servaient de magasin à l’escadrille, qui venait y faire son chargement.
Nous
en
prîmes
un
entre
autres,
un
trois
mâts,
par
le
travers
de
Raguse.
Il
revenait
du
Levant,
et
était
chargé
principalement
de
vin
de
Chypre
et
de
sucre
raffiné.
Tout
cela
fut
distribué
aux
Etats
majors
et
aux
équipages,
et,
pour
ma
part,
je
rapportai
à
la
maison
une
dame
Jeanne de vin de Chypre qui nous fit à tous bien plaisir ;
Ce
qu’il
y
a
de
singulier,
c’est
que
ce
navire,
qui
était
commandé
par
un
capitaine
Dalmate,
qui
s’appelait,
autant
que
je
me
souviens,
Obranowitch,
appartenait,
navire
et
cargaison,
à
Mr
Girardelli
de
Trieste,
le
beau
frère
de
Mr
Andrieu,
l’ancien
secrétaire
de
la
mairie
d’Ollioules,
et
par
qui
j’avais
été
admirablement
bien
reçu,
sur
la
recommandation
de
ce
dernier,
lorsqu’en
1848,
j’allais
à
Trieste
sur
la
frégate la Psyché.
C’est
à
ce
mouillage
devant
Venise
que
nous
apprîmes
par
les
bateaux
qui
revenaient
de
Rimini,
nous
apporter
des
vivres
frais,
les
deux batailles de Magenta et de Solferino.
Nous
fûmes
envoyé
par
l’amiral
pour
observer
les
mouvements
d’une
frégate
Autrichienne
qui
se
hasardait
à
sortir
de
Cattaro
pour
aller
jusqu’à
Ancône
et
vis
versa.
Nous
prîmes
mouillage
à
Antivari,
petit
port
forain
dépendant
du
Monténégro,
et
alors
occupé
par
les
Turcs
qui
avaient
établi
un
camp
dans
la
plaine
au
pied
du
mamelon
sur lequel la ville était bâtie.
Très
curieuse,
cette
petite
cité
qui
fut
d’une
certaine
importance
lorsque
la
république
de
Venise
était
maîtresse
de
toute
l’Adriatique
et
du
Levant.
On
y
voit
encore
d’anciennes
maisons
avec
les
armoiries
de
leurs
habitants
sculptées
au
dessus
de
la
porte
;
tout
cela,
quoiqu’en
ruines, témoigne encore d’une splendeur déchue.
La
conclusion
de
l’armistice
entre
la
France
et
l’Autriche,
et
la
paix
de
Villafranca,
mirent
fin
à
notre
peu
glorieuse
campagne
et
nous
rentrâmes
à
Toulon
ou
je
fus
débarqué
du
Napoléon
pour
embarquer
presque
immédiatement
sur
le
Grondeur,
bateau
hôpital,
qui
transporta
des
blessés
et
des
malades
à
Toulon
pendant
environ
deux
mois.
Puis
nous
fîmes
encore
quelques
voyages
pour
transporter
du
matériel
d’ambulance,
et
une
foule
d’impedimenta
hors
service.
C’est
alors
qu’après
avoir
assaini
et
purifié
autant
que
possible
ce
vieux
bateau,
je
profitais
du
dernier
voyage
pour
faire
visiter
Gênes
à
ma
femme.
De
retour
à
Toulon,
le
Grondeur
désarmant,
je
fus
embarqué,
en
cours
de
campagne
sur
le
Panama
qui
allait
désarmer
à
Brest.
Nous
nous
sommes
trouvés
dans
ce
port
un
grand
nombre
de
chirurgiens
du
port de Toulon qui étaient venus comme moi désarmer leurs navires.
Comme
je
me
trouvais
en
cours
de
campagne,
je
fus
embarqué
sur
l’Algésiras
qui
était
en
commission
de
rade,
et
sur
lequel
le
contre
amiral Paris avait son pavillon.
Je
passai
là
tout
l’hiver
et
une
grande
partie
du
printemps,
et
en
profitai
pour
travailler,
car
toutes
ces
pérégrinations
et
déplacements,
pendant
cette
guerre
de
1859
nous
dérangeaient
beaucoup
de
nos
études.
Entre
temps,
que
les
peuples
se
massacraient
à
l’envie,
et
cela
pour
faire
de
la
mauvaise
besogne,
comme
la
suite
des
temps
la
démontré,
l’académie
des
sciences
était
le
champ
de
bataille
ou
se
battaient
des
questions
scientifiques
d’un
très
haut
intérêt,
et
qui
tenaient en éveil tout le monde savant.
D’un
coté
Georges
Pouchet
soutenait
avec
un
talent
incontestable
la
théorie
de
la
génération
spontanée,
théorie
matérialiste,
que
combattait
avec
une
logique
serrée
et
étayée
d’expériences
lumineuses
l’illustre
Pasteur,
développant
sa
doctrine
microbienne
dont
les
conséquences
ont
une
portée
qu’à
cette
époque
on
ne
prévoyait
pas
encore,
malgré
que
l’application
en
eu
été
déjà
faite
à
l’occasion des épizooties qui décimaient les troupeaux.
Une
compagnie
Anglaise,
la
compagnie
Powel
qui
possédait
d’immenses
troupeaux
de
bêtes
à
cornes
sur
les
bords
du
Danube,
subissait
des
pertes
considérables
dans
son
exploitation
des
conserves
de
beauf
bouilli,
par
suite
d’épizooties,
le
typhus
des
bêtes
à
cornes.
Les
découvertes
de
Pasteur,
et
la
vaccination
de
ces
animaux
par
les
procédés
indiqués
par
le
savant,
sauvèrent
cette
compagnie
de
la
ruine, et depuis, elle a réalisé des bénéfices considérables.
L’étude
des
ferments
dans
le
vin,
la
bière,
le
chauffage
des
vins,
sont
les
moindres
résultats
des
doctrines
qu’il
a
popularisées.
De
plus,
ses
travaux
ont
ouvert
la
voie
si
étonnante
d’une
médecine
nouvelle
qui
dans
un
demi-siècle,
aura
complètement
transformé
l’art
de
guérir
;
Aussi
est-ce
avec
raison
et
justice,
que
Pasteur
a
été
unanimement
proclamé un bienfaiteur de l’humanité.
J’eu
l’occasion
de
lui
parler
plus
tard
en
1866
de
l’arsenal
de
Castigneau
à
Toulon
ou
il
était
venu
pour
apprendre
aux
employés
des
vivres,
le
procédé
du
chauffage
des
vins
pour
les
empêcher
de
tourner
à
l’aigre
dans
les
pays
intertropicaux.
Les
membres
de
la
commission
des
vins,
dont
je
faisais
partie,
avaient
reçu
l’ordre
d’expérimenter
l’extrait
de
viande
Liebig,
et,
en
voyant
cette
matière
il
nous
demanda
ce que c’était ?
Nous
le
lui
expliquâmes
;
il
sourit,
et
se
contenta
de
dire
«
tiens
!
Il
s’occupe
de
ces
choses
là
!!!
»
ce
qui
voulait
dire
que
le
chimiste
Prussien
Justus
von
Liebig,
fait
commandeur
de
la
légion
d’honneur
par
Napoléon
III,
faisait
de
la
science
productive,
mais
qu’il
ne
faisait
pas comme lui de la science pure.
Novembre 1860
Enfin
s’ouvrit
le
premier
octobre
1860,
un
concours
pour
plusieurs
grades
dans
le
port
de
Toulon.
Il
y
avait
trois
places,
nous
étions
quatorze
concurrents
dont
onze
présents
et
trois
qui
concouraient
à
l’absence.
La
lutte
fut
chaude
et
les
questions
posées
traitées
de
telle
manière
que
les
trois
concurrents
à
l’absence
furent
éliminés.
Je
pris
modestement
la
seconde
place.
Ce
jour
là
mon
excellent
père
pleura
de
joie
et
nous
fîmes
un
petit
dîner
de
famille
pour
arroser
mon troisième galon.
Je
fus
du
service
à
terre
pendant
un
mois
environ,
et
j’embarquai
en
commission
de
rade
sur
la
frégate
l’Impératrice
Eugénie,
c’est
à
ce
moment
là
que
je
pus
terminer
la
citerne
de
la
campagne,
et
j’implorais
tous
les
saints
du
Paradis
pour
qu’un
orage
vint
la
remplir,
si
bien
que
Boyer
Ressés,
lieutenant
de
vaisseau
à
bord,
ne
manquait
jamais,
toutes
les
fois
que
le
temps
s’assombrissait,
à
s’écrier
:
ce
sacré
Lespinois avec sa citerne, il va nous faire venir la pluie !!
Mais
le
temps
marchait,
et
à
la
fin
de
mars
1861,
je
fus
désigné
pour
aller
remplacer
un
collègue
qui
rentrait
en
France,
de
la
Cochinchine.
Il
fallait
se
dépêcher
d’organiser
mon
bazar
pour
partir,
car
la
frégate
l’Asmodée
qui
allait
partir
pour
Alexandrie
avait
reçu
l’ordre
de
s’apprêter vivement.
Pendant
que
ma
femme
me
préparait
mes
malles,
choses
à
laquelle
elle
était
habituée
depuis
longtemps,
je
courus
embrasser
ma
petite
Eugénie
qui
née
en
janvier,
était
nourrie
à
Ollioules.
La
pauvre
mignonne
ne
comprenait
rien
à
ce
redoublement
de
caresses
que
je
lui
fis.
J’allais
faire
mes
adieux
à
mes
parents
et
j’embrassais
mon
cher
père
pour
la
dernière
fois.
Je
partis
laissant
tout
mon
monde
dans
les
larmes.
Il
ne
valait
pas
la
peine
de
tant
presser
le
départ
de
la
frégate,
car
j’ai
séjourné
deux
grands
mois
à
Alexandrie,
à
attendre
que
le
navire
qui
devait
me
conduire
en
Cochinchine
fut
arrivé
à
Suez
;
car
à
cette
époque
le
canal
n’était
pas
achevé,
tant
s’en
fallait
;
et
il
y
avait
dans
toute
l’Egypte
des
agents
anglais
qui
détournaient
les
fellahs
d’aller
travailler
au
canal
en
leur
faisant
croire
qu’on
ne
les
payerai
pas
et
que
c’était
un
prétexte
pour
les
incorporer
de
force
dans
l’armée
du
Khédive.
Comme
l’Asmodée
repartit
pour
Toulon,
on
embarqua
tous
les
passagers,
officiers
et
matelots,
sur
un
transport
qui
était
en
station
à
Alexandrie
et
dont
le
second,
David
était
le
frère
de
Pierre
David
chef
d’atelier de la Ciotat.
Enfin,
dans
les
premiers
jours
de
Juin,
le
grand
transport
le
Dryade
arriva
à
Suez,
et
on
forma
à
Alexandrie
un
train
spécial
considérable
pour
transporter
à
Suez
tous
les
passagers,
les
vivres,
les
munitions
et
autres
impedimenta
qui
devraient
être
transportés
à
Saigon
par
la
Dryade.
Nous
restâmes
quelques
jours
à
Suez
;
et
là
il
m’arriva
une
petite
aventure
qui
mérite
d’être
notée.
Un
jour,
en
rentrant
à
bord,
au
moment
de
passer
du
quai,
je
fus
accosté
par
un
Quidam
qui
était
assez
pauvrement
vêtu,
vieux
pantalon,
redingote
presque
usée,
un
fez
arabe
sur
la
tête,
et,
pour
tout
bagage,
une
chemise
de
couleur
dans
un mouchoir.
Me
prenant
pour
un
officier
de
la
Dryade,
cet
individu
me
demanda
s’il
n’y
avait
pas
moyen
d’embarquer
gratuitement
sur
le
navire,
offrant
de
payer
son
passage
en
faisant
fonction
de
domestique,
qu’il
était
garçon
de
café
au
Caire
et
qu’il
voulait
essayer
de
tenter
la
fortune
en
Cochinchine, en faisant tel métier qu’il serait possible de le faire.
Je
lui
répondis
que
je
n’étais
que
passager
à
bord
du
Dryade,
mais
que
je
pourrai
parler
en
sa
faveur
au
lieutenant
et
que,
le
lendemain,
je
lui
donnerai une réponse en descendant à terre ;
Le
lieutenant
était
Panon
du
Hazier,
gendre
de
Mr
Baptistin
Auban,
je
le
connaissais
déjà
et
lui
parlai
de
la
demande
faite
par
cet
individu
;
Or
il
y
avait
énormément
d’officiers
passagers,
et
justement
le
maître
d’hôtel avait demandé son débarquement à Saigon.
Du
Hazier
était
donc
fort
embarrassé
pour
le
service
de
la
table
de
tant
de
passagers.
Il
prit
la
balle
au
bond
et
pria
de
dire
à
cet
homme
qu’il
pouvait
venir
et
qu’on
tacherait
d’arranger
la
chose.
Il
se
trouva
que
cet
homme
était
intelligent
et
très
débrouillard.
Pendant
toute
la
traversée,
nous
fûmes
très
bien
servis,
car
il
avait,
à
son
tour,
stylé
quelques matelots qui le secondaient bien.
Bref
quand
nous
débarquâmes
à
Saigon,
chacun
lui
donna
sa
pièce.
Ce
fut
le
commencement
d’une
fortune
assez
rondelette
qui
fût
édifiée
assez rapidement avec intelligence et même honnêteté.
J’allai
embarquer
sur
une
canonnière
qui
devait
partir
le
lendemain
pour
Mytho,
dans
les
environs
duquel
le
Du
Chayla
grande
frégate
était
mouillée
et
je
pris
possession
de
mon
service
qui
n’était
pas
une
sinécure,
car
nous
étions
presque
en
épidémie
perpétuelle
;
accès
de
fièvre
de
toutes
formes,
accès
pernicieux,
affections
du
foie,
coliques
sèches, choléra foudroyant, bref toutes les herbes de saint Jean.
Nous
avions
à
bord
une
compagnie
du
103ème
de
ligne
avec
ses
officiers,
et
une
compagnie
de
débarquement
du
bord
;
tout
ce
monde
s’en
allait
dans
des
embarcations
armées
en
guerre
sous
le
commandement
d’Amet,
alors
lieutenant
de
vaisseau,
actuellement
vice
amiral
en
retraite,
et
on
poursuivait
les
pavillons
noirs
de
tous
les
cotés
:
on
en
tuait
quelques-uns,
on
en
faisait
prisonniers
quelques
autres,
que
le
commandant
le
Bris
faisait
pendre
immédiatement
haut
et
court,
si
bien,
qu’au
bout
de
peu
de
temps,
la
région
était
tranquille,
mais
la
frégate
était
baptisée
du
nom
de
potence
;
car,
pour
le
15
Août,
fête
de
l’empereur,
les
basses
vergues
étaient
garnies
de
pendus
en
guise de lanternes vénitiennes !!
C’est
là
que
j’ai
pu
m’assurer
de
l’indifférence
de
ces
peuples
pour
la
mort,
qu’ils
regardent
comme
un
incident
dans
la
vie,
ce
qui
est
dû,
selon
moi,
à
la
croyance
des
réincarnations
successives
de
l’âme
humaine,
qui
est
un
des
dogmes
fondamentaux
de
la
doctrine
de
Bouddha.
Nous
menâmes
cette
vie
là,
pas
très
agréable,
du
reste,
pendant
plusieurs
mois,
et
nous
rentrâmes
à
Saigon
pour
nous
ravitailler
et
débarquer les troupes que nous avions à bord.
C’est
alors
que
me
promenant
dans
la
ville
que
je
ne
connaissais
pas
encore,
je
revis
cet
homme
que
j’avais
fait
embarquer
sur
la
Dryade
à
Suez.
Avec
l’argent
qu’on
lui
avait
donné,
il
avait
loué
une
petite
case
en
bois
à
la
devanture
de
laquelle,
il
avait
inscrit
lui-même
Buvette
des
Sous-officiers
comme
je
passai
devant,
il
me
reconnut,
vint
à
moi
et
se
confondit
en
remerciements
;
répondant
à
ma
question
s’il
faisait
ses
affaires
?
Il
me
dit
qu’il
était
très
content
et
que
non
seulement,
il
faisait
bien
avec
sa
buvette,
mais
que,
comme
il
savait
aussi
faire
la
cuisine,
on
allait
chez
lui
manger
un
morceau
sur
le
pouce
et
que
les
bénéfices étaient tels qu’il en était lui-même étonné.
Bref
pour
finir,
je
le
revis
prés
d’un
an
plus
tard.
A
coté
de
la
buvette
qui
existait
toujours,
je
vis
un
magasin
ou
l’on
vendait
des
plumes,
du
papier,
de
l’encre,
des
enveloppes,
et
ensuite
un
fond
de
livres,
de
brochures
et
romans.
Il
me
vit
et
en
souriant,
me
dit,
J’avais
entendu
dire
depuis
quelque
temps
que
les
officiers,
les
malades,
les
sous
officiers
s’ennuyaient
beaucoup
depuis
que
les
expéditions
étaient
finies.
Alors
je
me
dis
que
si
ces
messieurs
et
tout
ce
monde
là
avait
des
livres,
des
romans,
enfin
une
bibliothèque
à
leur
disposition,
ils
seraient
enchantés,
j’écrivis
à
ma
femme,
en
lui
envoyant
une
assez
forte
somme,
d’acheter
tous
les
rossignols
de
librairie
qu’elle
pourrait
se
procurer
à
bas
prix,
d’y
ajouter
tous
les
articles
de
papeterie,
de
faire
enfermer
tout
cela
dans
de
grandes
caisses
et
de
venir
me
rejoindre.
Oh
monsieur
vous
ne
pouvez
pas
vous
figurer
l’effet
produit
dans
la
ville
et
dans
toute
l’escadre
par
l’ouverture
de
ce
magasin
que
ma
femme
tenait
avec
politesse
et
intelligence.
Cela
m’était
enlevé
à
n’importe
quel
prix,
au
point
que
j’ai
été
obligé
d’écrire
en
France
pour
en faire venir d’autres.
Bref,
j’ai
réalisé
des
bénéfices
énormes
et
je
suis
en
train
de
faire
fortune et c’est à vous monsieur le Docteur, que je le dois.






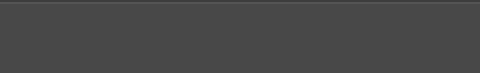
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu
eiusmod lorem
MonsiteWeb.com



- Accueil
- Index-a
- D-a
- D-a
- V-a
- V-nb
- V-nc
- V-nd
- V-na-a2-a
- V-na-a3-a
- V-na-a4-a
- V-na-a5-a
- V-na-a6-a
- V-na-a7-a
- V-na-a8-a
- V-na-a9-a
- V-na-a9-a
- Fl1860-a
- V_gouv-a
- V_puits-a
- V_puits1-a
- V_puits2-a
- V_gouv-a
- Tem-a
- Tem_les1-a
- Tem_les1-a
- Tem_les-a
- Tem_thib-a
- Tem_gir1-a
- Tem_gir2-a
- Tem_gir3-a
- Tem_themis-b
- Tem_toulon1-a
- Tem_toulon2-a
- Tem_lesg-a
- Tem_isis-a
- Tem_dordo-a
- Tem_primauguet-a
- Tem_dordo-a
- Arm-a
- Arm-seb1-a
- Arm-seb2-a
- Arm-seb3-a
- Arm-can-a
- Arm-can-a
- T-a
- T-b
- Z-a
- T-hel-a
- T-hel-a
- H-a
- H_1870-a
- H_1870-b
- H_1870-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_mexique-a
- H_crime-a
- H-mex-a
- H-mex2-a
- H-mex2-a
- Ch-a
- Ch-liste-a
- Per-a
- Per-a
- Per-a

























