

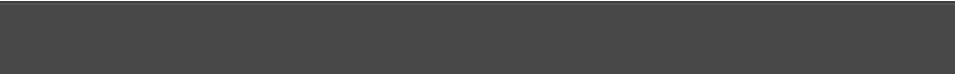
© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr
La flotte de Napoléon III - Documents

Témoignages
Charles-Henri Bonnescuelle de Lespinois (3)
… SUITE 2 (Charles-Henri de Lespinois)
Le
fait
est
que
ce
brave
garçon
s’est
si
bien
débrouillé,
qu’à
l’heure
qu’il
est
il
a
un
fils
qui
est
millionnaire.
Il
est
vrai
que
je
ne
le
suis
pas,
système
des compensations !
On
nous
envoyait
de
temps
à
autre
sur
le
fleuve
en
amont
de
Saigon,
à
environ
trente
cinq
milles
au
nord
de
cette
ville
dans
un
point
ou
était
un
gros
village
annamite
et
un
fort
ou
il
y
avait
une
garnison
d’infanterie de marine.
Ce
village
s’appelait
Phu
yen
mott,
les
environs
étaient
infestés
de
tigres,
et
il
n’était
pas
rare
le
soir,
à
la
tombée
de
la
nuit,
d’entendre
tout
à
coup
dans
le
village,
un
grand
cri
suivi
d’un
charivari
formidable.
C’était
un
tigre
qui
venait
de
surprendre
un
habitant
sur
le
pas
de
sa
porte,
l’avait assommé d’un coup de patte et l’emportait.
Aussitôt
tout
le
village,
hommes,
enfants,
femmes,
armés
de
torches,
se
mettait
à
la
poursuite
de
l’animal
et
quelque
fois
parvenait
à
lui
faire
lâcher sa proie qu’ils rapportaient pour lui donner la sépulture.
On
en
prenait
de
temps
en
à
autre,
dans
de
grandes
fosses
très
profondes
dissimulées
sous
des
branches
légères
garnies
de
gazon
et
de
feuillage
sur
lesquelles
on
avait
fixé
un
jeune
chien
ou
volatile
quelconque.
Ce
pays
là
était
plus
sain
que
le
district
de
Saigon,
car
il
était,
pour
ainsi
dire,
le
point
de
départ
du
delta
du
fleuve,
à
cause
de
l’altitude
du
terrain
et
des
collines
couvertes
d’une
futaie
magnifique
sous
laquelle
erraient
les
tigres,
les
panthères,
les
ours,
les
cerfs,
les
paons,
les
coqs
et
les
poules
cochinchinois
qui
ressemblent,
à
l’état
sauvage,
à
des
petites
autruches,
et
ou
le
soir,
l’on
voit
voltiger,
d’un
arbre
à
l’autre,
les
roussettes,
ces
immenses
chauve-souris
qui
ont
plus
d’un
mètre
d’envergure.
De
temps
à
autre,
on
entendait
des
appels
aux
armes,
des
détonations
sourdes,
c’étaient
des
partisans
ennemis
qui
étaient
établis
à
Bien
Hoa,
et
dans
les
environs,
et
qui
venaient
chercher
à
razzier
les
populations
chrétiennes qui étaient sous notre protection.
Le
commandant
envoyait
des
compagnies
de
débarquement
du
du
Chayla
et
des
canonnières
qui
étaient
avec
nous,
et
qui
étaient
chargées
de
la
police
du
fleuve
jusqu’à
une
distance
d’une
cinquantaine
de
milles
au nord.
On
faisait
la
poursuite
de
ces
gens
là,
une
guerre
de
partisans,
on
en
tuait
ou
blessait
toujours
quelques
uns
;
mais
ils
se
dérobaient
et
couraient comme des lapins effarouchés.
Un
jour,
on
en
prit
un,
homme
de
grande
taille,
à
figure
énergique,
qui était caporal.
Il
avait
reçu
une
balle
conique
à
la
partie
inférieure
de
la
jambe,
et
les
deux
os,
tibia
et
péroné,
étaient
brisés.
Malgré
cette
affreuse
blessure,
il
se
sauvait
assez
vite,
et
était
parvenu
à
se
faufiler
dans
des
broussailles,
dont
il
fut
assez
difficile
de
le
débusquer
quand
on
l’eut
retrouvé.
On
lui
demanda,
à
l’aide
de
l’interprète,
pourquoi
il
avait
tant
peur
de
tomber
entre
nos
mains,
et
il
donna
pour
raison
que
les
mandarins
leur
avait
dit
que
nous
faisions
mourir
les
prisonniers
dans
les
tortures, et que nous les mangions après.
On
me
fit
appeler
au
fort
pour
l’examiner
et
comme
l’amputation
était
absolument
nécessaire,
je
retournai
à
bord
chercher
tout
ce
qui
était
nécessaire,
ainsi
que
mon
second
chirurgien
auxiliaire.
(il
s’appelait
Teulière,
actuellement
il
exerce
la
médecine
à
Tarascon
dans
l’Ariège).
Quand
le
blessé
vit
qu’on
allait
lui
couper
la
jambe,
il
chercha
s’échapper,
et
il
ne
resta
tranquille
et
ne
se
soumit
à
l’opération
que
lorsque
l’interprète,
sous
le
serment
solennel
des
Annamites,
lui
eut
juré
que
les
Français
avaient
un
remède
qui
empêchait
de
souffrir,
et
que
pendant
qu’on
faisait
l’opération,
on
était
dans
le
septième
ciel
de
Bouddha.
Il
se
laissa
faire,
je
l’endormis,
je
l’amputais
au
dessous
du
genou
et
je
le
pansais,
tout
cela
assez
lentement
pour
qu’il
put
croire,
quand
il
revint
à lui, que rien ne s’était passé.
L’interprète
me
le
dit,
et
alors
je
dis
à
un
matelot
qui
était
là
de
lui
montrer
sa
jambe.
Alors
il
me
regarda
en
ouvrant
de
grands
yeux
et
en
lançant
à
plusieurs
reprises
l’interjection,
chah
!
chah
!
chah
!
Il
me
prit
la main et la baisa.
Ce
pauvre
homme
n’eut
pas
un
moment
de
fièvre,
pas
même
la
fièvre
traumatique.
Il
guérit
comme
par
enchantement,
et
comme
nous
repartions
à
cette
époque
pour
redescendre
à
Saigon,
je
recommandais
à
mon
collègue
qui
me
remplaçait
de
lui
faire
confectionner
une
jambe
en bois.
En
ce
moment,
le
nouveau
gouverneur,
l’amiral
Bonnard
réunissait
à
Saigon
tous
les
navires
et
principalement
toutes
les
grandes
canonnières,
ainsi
que
les
troupes
de
terre,
chasseurs
à
pied,
espagnols,
infanterie
de
marine,
et
les
compagnies
de
fusiliers
matelots,
pour
attaquer
les
forts
et
la
citadelle
de
Bien
Hoa,
d’où
les
mandarins
envoyaient
constamment
des
troupes
irrégulières
pour
harceler
et
inquiéter
les
villages
soumis
à
notre
influence.
Le
du
Chayla
commandait
en
chef
la
flottille
et
les
troupes
qui
devaient
agir
à
terre
en
opérant un grand mouvement tournant.
Le
15
Décembre
1861,
la
flottille
commença
le
feu
à
8
heures
du
matin
contre
les
forts
qui
commandaient
les
abords
de
la
ville
et
de
la
citadelle
de
Bien
Hoa.
Ces
forts
étaient
situés
à
cinq
milles
en
aval
de
la
ville
et
répondirent
par
un
feu
bien
nourri
à
notre
canonnade
Ils
tinrent
bon
jusqu’à
11
heures,
mais
à
ce
moment
les
défenseurs
des
forts
entendant
derrière
eux
les
fanfares
des
chasseurs
à
pied,
et
craignant
d’être
pris
entre
deux
feux,
abandonnèrent
tout
et
se
faufilant
dans
les
broussailles,
regagnèrent
la
ville
à
travers
champs
et
dans
des
endroits
ou il était impossible de les poursuivre.
Alors
il
arriva
une
chose
affreuse,
le
lendemain
on
vit
s’élever
au
dessus
de
la
ville
une
fumée
noire
intense,
et
on
entendit
des
cris,
une
rumeur
formidable
;
Il
y
avait,
enfermés
dans
les
paillotes
environ
trois
cents
indigènes
chrétiens.
Les
mandarins
firent
entourer
ces
paillotes
par
un
double
cordon
de
sentinelles
et
mettre
le
feu
à
ces
abris
qui
se
mirent
à
flamber
comme
des
allumettes.
Les
malheureux
qui
cherchaient
à
sortir
de
cette
fournaise
y
étaient
rejetés
à
coup
de
lance.
Ils
y
furent
tous
consumés,
et
l’odeur
de
ces
malheureux
brûlés
vifs,
non
seulement
fut
perçue
par
nous
qui
étions
à
six
milles
de
la
ville, mais encore par les habitants de Saigon !!
L’amiral
gouverneur
arriva
sur
ces
entrefaites
avec
une
canonnière
qui
alla
jusque
sous
les
murs
de
la
ville.
Elle
lança
un
obus
qui
traversa
le
rempart
et
alla
éclater
juste
dans
la
poudrière
qui
sauta
en
l’air.
Ce
fut
alors
une
panique
formidable
parmi
toutes
ces
troupes
qui
entraînant
leurs
mandarins
avec
elles,
se
sauvèrent
bien
loin
et
je
crois
qu’ils
firent
bien,
car
l’amiral
était
décidé
à
faire
payer
cher,
surtout
aux
mandarins,
l’acte
de
cruauté
dont
ils
venaient
de
se
rendre
coupables.
Et
on
mit
une
bonne
garnison
dans
la
citadelle,
et
tout
le
corps expéditionnaire rentra à Saigon.
Quelques
jours
après,
je
me
promenai
un
matin,
sur
la
place
du
marché
qui
était
très
animée
et
très
curieuse
à
voir,
lorsque
je
me
senti
saisir
et
embrasser
la
main
;
je
me
retournai
et
je
reconnus
mon
amputé
de
Phu-yen-Mott
qui,
comme
Bélisaire,
avec
une
écuelle
de
bois,
sollicitait
la
charité
publique,
je
m’empressai
de
mettre
dans
son
écuelle
un
quart
de
piastre
et
je
le
saluai
de
la
main.
Je
le
vis
alors
de
loin,
pérorant
au
centre
d’un
grand
rassemblement
d’indigènes
il
racontait
probablement
son
épopée,
et
les
rapports
qu’il
avait
eus
avec
moi.
On
dit,
et
je
crois,
avec
raison,
qu’une
action,
louable
porte
ses
fruits…
Le
soir
même,
nous
étions
allés
voir
un
lieutenant
de
vaisseau
de
nos
amis,
(Vial,
aujourd’hui
capitaine
de
vaisseau
en
retraite)
qui
était
capitaine
du
port
de
commerce,
Il
y
avait
dans
son
immense
chambre
une
épinette,
dans
ce
moment
étaient
en
visite
également
chez
lui
le
señor
de
Palanca
y
Guttierez,
colonel
général
des
troupes
espagnoles
et
plusieurs
officiers
de
ces
troupes.
On
se
mit
à
chanter,
et
comme
j’avais
de
la
voix,
on
me
pria
de
chanter
quelque
chose.
Je
me
suis
mis
au
piano,
et
j’eus
l’inspiration,
pour
plaire
aux
Espagnols
de
chanter
une
seguedilla
Espagnole
que
j’avais
appris,
dans
le
temps,
à
St
Jean
de
Porto-Rico
dans
les
Antilles.
Ces
messieurs
furent
enchantés,
le
colonel
qui
était
un
gentleman
très
bien,
me
fit
beaucoup
de
politesses
et,
ou
même
temps,
me
demanda
si
je
voudrais
me
charger
du
service
médical
des
Espagnols,
attendu
qu’eux,
n’ayant
pas
de
médecin,
c’était
un
docteur
Français
qui
les
soignait.
Le
chirurgien
de
première
classe
qui
faisait
ce
service
était
reparti
pour
la
France,
et
il
me
déclara
qu’il
serait
très
désireux
de
me
voir
lui
succéder,
Je
lui
répondis
que
je
ne
pouvais
le
faire
sans
l’autorisation
de
mon
commandant.
Alors
il
lui
fit
une
visite
à
mon
commandant
le
Bris
qui
lui
assura
que
pourvu
que
le
service
du
bord
n’en
souffrit
pas,
il
m’autorisait
parfaitement
à
faire
celui
des
Espagnols
et
je
le
fis
pendant
tout
mon
séjour
en
Cochinchine, ce qui m’a valu la croix d’Isabelle la catholique.
1862 25 avril
Après
avoir
assisté
à
la
conquête
de
la
Cochinchine,
je
revins
en
France,
désarmer
le
du
Chayla
à
Lorient.
En
arrivant,
j’appris
la
mort
de
mon
excellent
père
;
et
j’éprouvais
tout
ce
qu’on
peut
souffrir
en
perdant son ami le plus cher et le plus dévoué.
Je
crois
n’avoir
payé
que
bien
faiblement
un
tribu
mérité
en
faisant
ressortir
au
commencement
de
ce
récit,
toutes
les
qualités
maîtresses
qui
caractérisent
un
homme
de
bien
et
qui
était
son
apanage.
Ce
n’est
que
trop
tard
hélas
!
Qu’on
sait
apprécier
des
hommes
pareils
;
aussi
je
pense
actuellement
toujours
à
lui,
et
plus
je
me
fais
vieux,
mieux
je
sens
tout
ce
que
je
dois
à
sa
sollicitude
et
à
son
dévouement
pour
ses
enfants.
Est-il
besoin
de
dire
que
les
déceptions,
les
chagrins
de
toute
espèce
ont
été
la
récompense
de
tant
de
vertus…
et
les
philosophes
de
la
plus
haute
antiquité,
auraient-ils
formulé
une
vérité
profonde,
en
établissant
que
le
mal
est
nécessaire
à
l’homme
comme
l’eau
glacée
l’est
à
l’acier,
pour
le
retremper
et
lui
préparer
les
récompenses
de
la
vie future !!!
1865
Après
avoir
passé
mes
examens
de
doctorat
à
la
faculté
de
Montpellier,
je
reçus
l’année
suivante
la
décoration
de
la
légion
d’honneur,
le
15
Août
1865,
après
vingt
trois
ans
de
services
assez
pénibles,
j’avais
huit
propositions,
j’avais
assisté
à
dix
épidémies,
fièvre
jaune,
dysenterie,
choléra,
typhus
etc.
Il
est
vrai
que
je
n’étais
pas
protégé et c’était le cas de dire mieux vaut tard que jamais
1868
En
1868,
obsédé
par
les
plaintes
de
ma
femme
qui
trouvait
que
nous
ne
pouvions
plus
vivre
avec
les
maigres
appointement
que
je
touchais,
surtout
pour
faire
face
aux
dépenses
d’éducation
de
mes
deux
fils
chez
les
Maristes
de
la
Seyne,
je
pris
le
parti
de
demander
ma
retraite,
en
espérant
que
la
médecine
civile
contribuerait
pour
beaucoup
à
améliorer
notre
condition.
J’étais
pourtant
le
premier
à
passer médecin principal à l’ancienneté !! Je passai le Rubicon.
Et
Dieu
sait
le
mal
que
je
me
suis
donné,
et
les
déceptions,
les
ennuis
de
toute
espèces,
les
pertes
d’argent
qui
m’ont
assailli
sur
l’autre
rive.
Jusqu’à
l’age
de
73
ans,
j’ai
travaillé
comme
manœuvre
ne
le
ferait
pas,
et
je
n’ai
pas
pu
sauver
un
liard
de
tout
l’argent
que
j’ai
fait entrer à la maison. …. Mais assez sur ce sujet, car il est fort triste.
Actuellement,
forcé
par
ma
surdité
de
renoncer
à
l’exercice
de
la
médecine,
je
vis
dans
le
passé,
car
le
présent
est
peu
brillant
et
l’avenir
est
dans
les
mains
de
l’esprit
supérieur.
Je
me
réfugie
dans
la
lecture,
et
les
livres
sont
des
amis
qui
ne
trompent
pas
toujours,
quand
on
sait
bien les choisir.
Je
m’intéresse
à
tous
les
progrès
de
l’esprit
humain,
et
je
suis
vraiment
heureux
quand
je
puis
enregistrer
une
invention,
une
découverte
profitable
à
l’humanité,
car
cela
me
console
des
saletés
de
la
politique
qui
est
en
ce
moment
le
chancre
rongeur
de
cette
nation
Française si gaie et si intéressante.



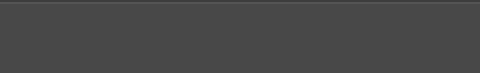
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu
eiusmod lorem
MonsiteWeb.com



- Accueil
- Index-a
- D-a
- D-a
- V-a
- V-nb
- V-nc
- V-nd
- V-na-a2-a
- V-na-a3-a
- V-na-a4-a
- V-na-a5-a
- V-na-a6-a
- V-na-a7-a
- V-na-a8-a
- V-na-a9-a
- V-na-a9-a
- Fl1860-a
- V_gouv-a
- V_puits-a
- V_puits1-a
- V_puits2-a
- V_gouv-a
- Tem-a
- Tem_les1-a
- Tem_les1-a
- Tem_les-a
- Tem_thib-a
- Tem_gir1-a
- Tem_gir2-a
- Tem_gir3-a
- Tem_themis-b
- Tem_toulon1-a
- Tem_toulon2-a
- Tem_lesg-a
- Tem_isis-a
- Tem_dordo-a
- Tem_primauguet-a
- Tem_dordo-a
- Arm-a
- Arm-seb1-a
- Arm-seb2-a
- Arm-seb3-a
- Arm-can-a
- Arm-can-a
- T-a
- T-b
- Z-a
- T-hel-a
- T-hel-a
- H-a
- H_1870-a
- H_1870-b
- H_1870-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_mexique-a
- H_crime-a
- H-mex-a
- H-mex2-a
- H-mex2-a
- Ch-a
- Ch-liste-a
- Per-a
- Per-a
- Per-a

























