

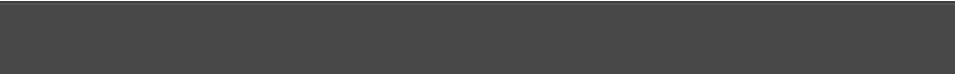
© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr
La flotte de Napoléon III - Documents

Navires allongés (annexe 6) par Claude Millé
Ce dossier comprend les annexes suivantes (accessibles par les barres de navigation).:
annexe 1 : copie de la dépêche ministérielle adressée au Préfet Maritime de Rochefort pour les plans de la Sémiramis.
annexe 2 : Liaisons longitudinales" - extrait du traité de A. de Fréminville.
annexe 3 : étude du CV Brisou sur les navires allongés.
annexe 4 : note sur l'opération de descente de l'Eylau, par Dupuy de Lôme, 1853.
annexe 5 : halage de la frégate Amazone à Brest.
annexe 6 : - la frégate l'Astrée, par Claude Millé.
- notes sur les frégates du CV Brisou.
annexe 7 : extrait du livre "la révolution de la vapeur dans les marines du XIXe siècle".
annexe 8 : - dimensions comparées de la quille.
- note biographique sur le LV Texereau.
annexe 9 : galerie iconographique.
1. la Frégate l'Astrée
La frégate mixte l’Astrée a été sortie de l’anonymat par la découverte, dans une malle familiale, d’un journal personnel du lieutenant de
vaisseau Ange Edmond Bourbonne par son arrière petit fils Louis Bienvenüe. Ce journal était accompagné d’un album de plus de 100 photos
d’escales qui se sont révélées avoir été prises, pour la plupart, par Paul Emile Miot (pour la plupart, car des photos de Lima, Callao ou Papeete
ont été achetées à « Courret Hermanos, calle Mercaderes, Lima », d’autres, de San Francisco, proviennent d’Edward Muybridge, photographe
anglais établi à San Francisco…)
Mise sur cale à Lorient en 1845 sur plans de l’ingénieur Legrix, elle ne fut mise à l’eau que le 24 décembre 1859 : entre temps, sa coque
avait été rallongée de cinq entre-axes de sabords (16,40 m), son avant et son arrière modifiés (plans Sollier), pour recevoir une machine à vapeur
de 600 chevaux nominaux et ses 6 corps de chaudières. Dotée d’un puits d’hélice et d’une hélice relevable, sa coque en bois est habillée de
plaques de cuivre dans ses oeuvres vives; elle a un gréement de frégate complet (gréement dormant en torons de fil de fer zingué), elle fut
armée en transport de troupes en 1862 lors de la guerre du Mexique (Lorient – Fort de France – Vera-Cruz et retour).
De
1863 à 1866 elle fit partie de la station navale du Brésil et de la Plata (Capitaine de vaisseau Jouslard, contre-amiral Chaigneau). A Rio de Janeiro
elle reçut l’empereur du Brésil Pedro II (gravure de Lebreton).
De 1868 à 1871, elle porta le pavillon du contre amiral Georges Cloué, commandant la station navale du Pacifique. Celle-ci se composait de la
frégate mixte Astrée, des avisos La Motte-Picquet et d’Entrecasteaux et du transport la Mégère.
dommages sur l'avant de l'Astrée (photo E. Miot)
L’Astrée était commandée par le capitaine de vaisseau Peyron, futur contre amiral et ministre de la marine. Le capitaine de frégate Miot était
chef d’état-major de l’amiral. Il s’était déjà distingué lors de campagnes à Terre-Neuve en faisant de la photographie. Il en laissera des collections
(Musée de l’Homme de Paris, Archives du Canada, Archives de la marine de Vincennes, collections particulières Jean-Yves Tréhin, Serge Kakou,
Louis Bienvenüe).
Après escales aux Canaries, à St Vincent du Cap Vert, à Montevideo, elle passa par le canal de Magellan et les canaux latéraux de Patagonie,
où elle s’endommagea la quille et l’étrave sur une roche. Suivent ensuite des escales sur les côtes d’Amérique du Sud. Au Pérou, à Callao, on
répara les dommages sur le dock flottant.
C’est ensuite Panama, San Francisco (visite de l’amiral américain Farragut). L’etat-major visite le fort d’Alcatraz et ses canons géants. On fait
escale ensuite à Esquimalt Bay (île de Vancouver, Colombie Brittanique), puis c’est à nouveau San Francisco, et enfin Papeete.
L’Astrée y séjourne trois mois. Miot prend de nombreuses photos. Bourbonne devient le « tayo » d’Ariiaué, le futur Pomaré V « …en
connaissant mieux mon nouvel ami, je découvris chez lui un bien grave défaut, mon cher tayo est un ivrogne, plusieurs fois nous l’avons ramené
couché dans le fond de la voiture… » Visite et séjour à Atimaono, à la plantation Steward. Cloué complète l’hydrographie de la côte entre la
Pointe Vénus et Papenoo, on précise les contours du « Banc de l’Artémise », où Laplace endommagea sa frégate en l’échouant, en avril 1839.
Pendant le séjour de l’Astrée se place l’épisode « La Roncière » : «Le Commissaire Impérial La Roncière, demi-frère de l’amiral La Roncière Le
Noury, convaincu de détournements et turpitudes diverses, est évincé et lui et ses complices sont embarqués sur la frégate à voiles l’Alceste le
17 novembre 1869 pour être jugés en France » (*).
L’Astrée reviendra encore à Tahiti, en revenant des Marquises. Elle séjournera à Papeete du 22 juin au 1° septembre 1870 : « ….samedi 3
septembre 1870 (après le départ de l’Astrée). L’amiral Cloué a reçu avec la plus vive satisfaction le petit modèle de la frégate Astrée fait par
l’habile artiste M. Morand (**) et offert comme souvenir par MM. Les résidants de Tahiti… ».
Pendant le second séjour, le petit transport à voiles l’Euryale se perd sur un îlot de Starbuch. Cloué envoie le transport la Somme en secours.
Papeete reçoit la corvette russe Almaz (Diamant), la corvette américaine Resaca, la frégate à voiles Sibylle, les avisos d’Entrecasteaux et La
Motte-Picquet. Le transport la Mégère part pour la France, le transport à voiles le Chevert arrive de San Francisco et annonce à la colonie l’état
de guerre entre la France et la Prusse. Le 15 août 1870 l’Astrée reçoit la reine Pomaré. Le même jour a lieu une course de pirogues.
L’Astrée quitte définitivement Tahiti le 1° septembre 1870. Elle navigue le long des côtes d’Amérique du Sud, dans une inaction qui pèse sur
l’équipage, sans rencontrer de navire de guerre prussien ni sans arraisonner de navire marchand. Elle rentre en France le 21 janvier 1871 depuis
Valparaiso, passe le cap Horn, relâche à Dakar et arrive à Lorient le 8 avril. Elle est définitivement désarmée le 27 du même mois. Elle figure
encore sur la liste de la flotte de 1877 à « bâtiments maintenus provisoirement auxquels on ne travaillera qu’au fur et à mesure des besoins ».
Elle est rayée des listes à la fin de la même année et restera comme ponton, rasée, la guibre enlevée révèlant une étrave droite, jusqu’à sa
démolition en 1923. Depuis 1913, elle s’appelait « ponton magasin n°2 », son nom ayant été donné à un sous-marin. Elle servit à Lorient comme
ponton-caserne et comme poste d’armement de la direction du port.
Elle a une importante voie d’eau en 1911. Elle est vendue à M. ferrand, de Vannes, pour la somme de 96.213 f. Le 17 février 1923 elle quitte
Lorient pour St Nazaire, remorquée par l’Audax, pour sa démolition définitive.
Caractéristiques générales, après allongement sur cale :
longueur à la flottaison : 76,63 m (longueur hors râblure à
la flottaison en charge, c’est à dire qu’est comprise la
longueur de la cage d’hélice entre les étambots. La
longueur de râblure en râblure est de 74,52 m)– largeur
hors bordages 14,40 m – Tirant d’eau moyen 6,28 m
La machine à vapeur était à deux cylindres, à bielles
renversées (bielles « retour »), construite à Marseille-
Menpenti par l’ingénieur François Bourdon (la machine
est du type « Algésiras modifié », elle fut transportée de
Marseille à Lorient par le transport La Meuse.
Diamètre des cylindres 1,75 m. , course 1,06 m Vitesse
aux essais : 11 nœuds. Consommation de charbon
moyenne de 2 kgs par heure et par cheval indiqué. Hélice
Mangin à 2 ailes doubles , emmanchement de l’hélice
démontable par tronc de pyramide, butée mobile à
tourillons système Mazeline
Equipage 415 hommes.
Appréciation des commandants : « le navire est très mauvais marcheur à la voile » , « l’Astrée est une grande rouleuse à la voile et à la vapeur,
par mer de travers »
Artillerie : 12 canons de 16 cm, modèle 1864, se chargeant par la culasse, 4 canons de 16 cm, modèle 1860, se chargeant par la bouche.
Cheminée téléscopique dite « à longue-vue »
Embarcations : Une chaloupe à vapeur remplace la chaloupe de 11 m. un grand canot de 9,50 m, deux canots de 9,50 m, deux baleinières de
8,50 m, un youyou de 4 m.
Distillateur d’eau pour l’équipage (Modèle Sabattier), chaudières alimentées par l’eau de mer.
La frégate possède en équipement un scaphandre « Cabirol », système « Rouquayrol-Denayrouze »
Claude Millé
notes
(*) C’est du moins ce qu’écrit dans son journal personnel Ange Edmond Bourbonne, LV de l’Astrée. Il semble que cela soit l’opinion des officiers
de l’Astrée, qui s’alignaient, c’est compréhensible, sur celle du C.A. Georges Cloué . Il semblerait que la vérité historique soit toute autre, à lire le
très documenté ouvrage de Bertrand de la Roncière La Reine Pomaré, l’Harmattan, 2003.
Le comte Emile de La Roncière Commissaire Impérial des îles de la Société homme énergique et désirant commander sans partage avait bien
œuvré pour la prospérité de la colonie, mais s’était vite heurté aux autorités religieuses et à un groupe de petits fonctionnaires et de résidants
peu désireux de faire des concessions. Il eut de longs démêlés avec une reine qui louvoyait sans cesse avec le pouvoir impérial et son
représentant, et surtout avec l’Ordonnateur, responsable du budget de la colonie. Or, celui-ci était un commissaire principal de la marine. Il y eut
donc deux clans, la Marine et La Roncière. Tous deux désirant régner en maître La venue du C.A. Cloué commandant la station navale du
Pacifique précipita la déchéance de celui qu’on accusait de tous les maux. De La Roncière était, de plus, desservi par une vieille histoire de
jeunesse où il avait été injustement accusé d’un prétendu viol de la fille d’un général. Passé en justice, condamné, il avait été ensuite
complètement blanchi de cette grave accusation. Il en était resté un argument fallacieux q’utilisaient ses ennemis D’où les termes un peu
outranciers de « détournements », « turpitudes » et « complices » du journal du LV Bourbonne.
(**) Peut être le « Morand Olivier (1822-1880) » cité dans la biographie « Les Tahitiens » de Patrick O’Reilly ?
2. Note sur les frégates, du CV(H) Brisou


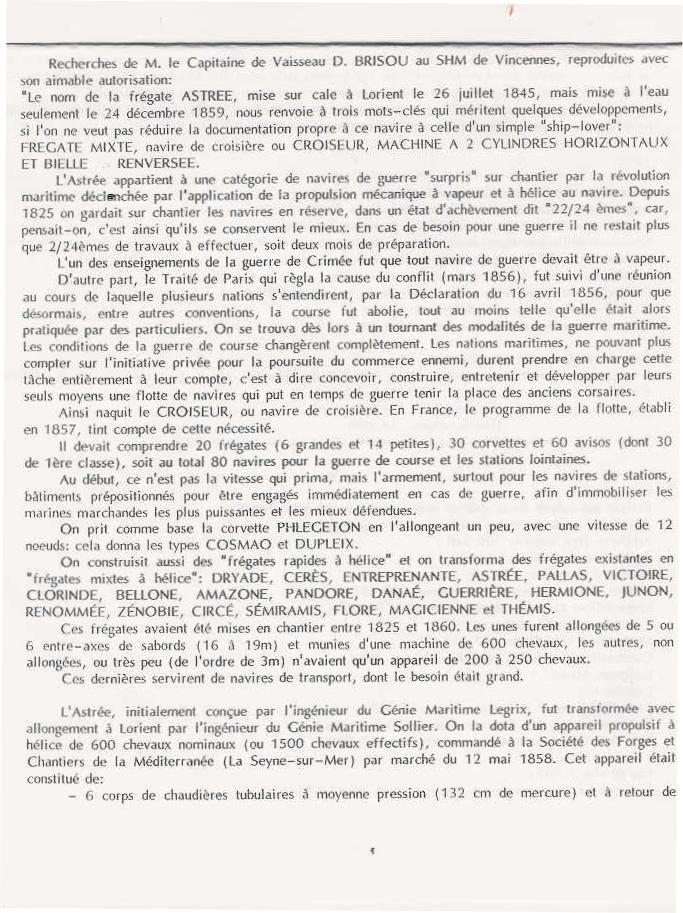




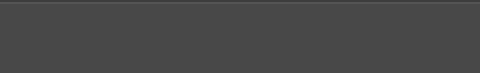
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu
eiusmod lorem
MonsiteWeb.com



- Accueil
- Index-a
- D-a
- D-a
- V-a
- V-nb
- V-nc
- V-nd
- V-na-a2-a
- V-na-a3-a
- V-na-a4-a
- V-na-a5-a
- V-na-a6-a
- V-na-a7-a
- V-na-a8-a
- V-na-a9-a
- V-na-a9-a
- Fl1860-a
- V_gouv-a
- V_puits-a
- V_puits1-a
- V_puits2-a
- V_gouv-a
- Tem-a
- Tem_les1-a
- Tem_les1-a
- Tem_les-a
- Tem_thib-a
- Tem_gir1-a
- Tem_gir2-a
- Tem_gir3-a
- Tem_themis-b
- Tem_toulon1-a
- Tem_toulon2-a
- Tem_lesg-a
- Tem_isis-a
- Tem_dordo-a
- Tem_primauguet-a
- Tem_dordo-a
- Arm-a
- Arm-seb1-a
- Arm-seb2-a
- Arm-seb3-a
- Arm-can-a
- Arm-can-a
- T-a
- T-b
- Z-a
- T-hel-a
- T-hel-a
- H-a
- H_1870-a
- H_1870-b
- H_1870-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_crime-a
- H_mexique-a
- H_crime-a
- H-mex-a
- H-mex2-a
- H-mex2-a
- Ch-a
- Ch-liste-a
- Per-a
- Per-a
- Per-a

























